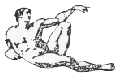MCX-APC (Accueil) > Notes de Lectures MCX
Cahier des Lectures MCX
Notes bibliographiques commentées établies parle Programme Européen MCX et l'Association pour la Pensée Complexe
|
Que vaut un livre?
"... Un livre vaut à mes yeux par le nombre et la nouveauté des problèmes qu'il crée, anime ou ranime dans ma pensée... J'attends de mes lectures qu'elles me produisent de ces remarques, de ces réflexions, de ces arrêts subits qui suspendent le regard, illuminent des perspectives et réveillent tout à coup notre curiosité profonde..." P. Valéry (Variété V), O.C. Pléiade I (p. 871) |
Recherche d'une note de lecture :
En cliquant sur la première lettre du nom de l'auteur du livre :
En utilisant les critères ci-dessous :
Les notes de lecture les plus récentes :
- [Janvier 2011] DELORME Robert - « DEEP COMPLEXITY and the SOCIAL SCIENCES Experience, Modeling and Operationality » par LABROUSSE Agnès
- [Janvier 2011] Edgar MORIN - « POUR ET CONTRE MARX » par ADAM Michel
- [Janvier 2011] Le LABO de l'ESS - « POUR UNE AUTRE ECONOMIE » par ADAM Michel
- [Octobre 2010] DELORME Robert - « DEEP COMPLEXITY and the SOCIAL SCIENCES Experience, Modeling and Operationality » par LE MOIGNE Jean-Louis
- [Octobre 2010] SIMON Herbert A. - « MODELS OF MY LIFE (AN AUTOBIOGRAPHY) » par LE MOIGNE Jean-Louis
|
Le "CAHIER des LECTURES MCX" constitue un des moyens d'action privilégiés par le Programme Européen Modélisation de la Complexité depuis 1991-92.
Il exprime le projet de veille épistémologique que nous proposons, tout en rendant visible la progressive constitution d'une bibliothèque des sciences de la complexité qui se construit dans les cultures contemporaines. Il ne s'agit pas ici de reproduire le prospectus de présentation ou le résumé établi par les éditeurs, mais de proposer des regards à la fois critiques et constructifs sur des textes qui peuvent et doivent intéresser chercheurs scientifiques et responsables d'organisations attentifs à la complexité de leurs initiatives. On souhaite que cette veille devienne de plus en plus une entreprise collective, chacun pouvant bien sûr proposer un regard "différent" sur un ouvrage déjà introduit, et mieux encore, faire part de ses propres attentions. Ceci en jouant de son mieux les règles du jeu de l'inter- et transdisciplinarité. La critique disciplinaire pointue dispose de nombre de publications qui la privilégient ; il s'agit ici d'un autre regard : une veille épistémologique qui privilégie la modélisation de la complexité et la pensée complexe. La reliance des projets du Programme Européen MCX et de l'Association pour la Pensée Complexe va nous permettre d'activer davantage cet exercice d'intelligence de la complexité, intelligence qui se développe en s'exerçant dans de multiples cultures. |