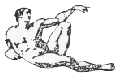| Rédigée par Maurice Pasdeloup sur l'ouvrage de STENGERS Isabelle : |
| « Sciences et pouvoirs » Editions La Découverte, 1997. |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
Dans nos sociétés, qui se veulent démocratiques, les données scientifiques sont souvent invoquées comme ultime argument d'autorité face au sens commun ou même contre les préférences de la population. De sorte que la science apparaît inévitablement comme produisant ou confortant la "pensée unique", voire comme étant d'essence prétotalitaire.
C'est cette identification que conteste dans ce petit livre "sabelle Stengers, en observant d'abord qu'elle ne tient que par la légende et le discours convenus où on ne donne à voir que "la science une fois faite". Elle montre ensuite que si on prend la peine d'élucider ce qui se passe vraiment dans "la science en train, de se faire", on en trouve une tout autre image : loin de s'opposer, sociétés démocratiques authentiques et communautés scientifiques bien comprises convergeraient vers les mêmes exigences. Il n'y aurait donc pas, comme le dit pourtant le sous-titre du livre, "la démocratie face à la technoscience", mais l'une et l'autre procéderaient idéalement des mêmes comportements et des mêmes modalités, et devraient donc marcher de concert. Bien sûr, l'auteur y insiste, nous sommes loin du compte, mais nos démocraties ont les sciences qu'elles méritent...
Nous avons d'abord à nous démarquer du critère trop restrictif de Popper : il pose l'impossibilité de la preuve mais il néglige tout le mal que les chercheurs doivent se donner pour faire exister les théories qu'ils produisent, au moins pendant le temps nécessaire pour leur mise à l'épreuve des faits.
Nous avons aussi à nous affranchir du "pouvoir du laboratoire", en partie illusoire quoi qu'en disent les sirènes de la méthode expérimentale normative... Ce lieu emblématique, le seul où théories et faits pourraient se confronter, ne répond qu'aux questions dont il peut produire la mise en scène. A ce sujet, "sabelle Stengers utilise une métaphore très heureuse qui valorise la situation : c'est comme un rendez-vous réussi entre le monde et les humains, dit-elle. Mais un rendez-vous réussi ne produit pas forcément une relation stable et durable..., car il y a des questions (et ce ne sont pas les moindres) que les hommes se posent depuis toujours.
Certains domaines ne se prêtent pas à ce type de confrontation de ce que prévoient leurs théories avec ce qui va arriver. C'est le cas des sciences humaines et sociales. L'auteur n'est pas tendre avec elles par ailleurs, mais souligne qu'elles produisent pourtant des modes inédits de lucidité. C'est le cas de l'histoire, et aussi de certaines sciences dont la démarche s'en rapproche nécessairement : les théoriciens de l'évolution en biologie sont justement qualifiés d'historiens de la vie et les géologues d'historiens de la terre.
L'auteur peut affirmer que les sciences font exister des êtres nouveaux fiables, parfaitement réels, non pas parce qu'elles sont objectives, mais parce qu'elles sont créatrices de liens nouveaux avec la réalité. Que ceci se fait toujours au sein d'une "communauté", où des chercheurs sont alternativement rivaux et alliés mais toujours partie prenante de ce qui va à la fin s'imposer. On n'est jamais scientifique tout seul. Elle a bien raison de rappeler que dans cette histoire (la galère du chercheur de base...), le rendement ne peut être optimal, des opportunités sont ratées. Nous disons parfois entre chimistes que nous avons tous jeté quelques prix Nobel à l'évier... suite à des expériences qui n'ont pas "marché" ou qui ne sont pas publiables.
On peut ainsi observer avec Edgar Morin qu'en définitive "toutes les sciences sont sociales". Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut. Mais le discernement auquel nous invite "sabelle Stengers se situe au niveau des pratiques, plutôt qu'à celui du produit fini de la recherche. Elle prône plus un modèle de choix et d'action qu'un modèle de pensée scientifique. C'est pourquoi elle se démarque de "l'écologie des idées" (cf. Gregory Bateson, Vers une écologie de l'esprit, Seuil, 1980) au profit d'une "écologie des pratiques", thème fort de sa série intitulée Cosmopolitiques (La Découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 1996-97).
C'est à ce niveau qu'elle peut montrer que pratiques de la science et pratiques de la démocratie se recoupent. Car la démocratie non plus ne se réduit pas à son aspect formel d'élections régulières et de loi de la majorité d'opinion. On en connaît les faillites dans les pays qui n'ont pas de passé dans ses pratiques. L'épaisseur historique qu'elle a chez nous fait que ce sont souvent des individus déterminés ou des minorités actives qui impriment les orientations nouvelles mieux adaptées, ceci tout en la confortant. Et tout en nous rappelant les risques de l'histoire et l'illusion du progrès. Isabelle Stengers nous explique joliment tout ça, de manière à la fois forte et subtile. Elle fait ressortir le rôle particulier des associations de toxicomanes, de malades du sida, qui ont su faire construire une définition de la drogue ou de leur maladie qui n'est plus purement médicale mais intègre une dimension politique. Ce qui oblige à la fois les médecins, les chercheurs et les politiques à considérer autrement leurs problèmes.
On peut se demander pourquoi elle se limite à ces seules catégories (peut-être simplement parce qu'elle les a particulièrement étudiées), au demeurant pas toujours exemplaires : des groupes d'homosexuels ont parfois exercé un véritable diktat sur la thérapeutique du sida, et à l'opposé, bon nombre d'associations de malades sont créées, manipulées ou récupérées par les médecins. Il me semble que dans le pré-carré du nucléaire, particulièrement depuis le mensonge de Tchernobyl en France, des actions fiables et pertinentes, associant des scientifiques et des citoyens motivés, ont obligé à la fois les technocrates à revoir leur méthodologie et les politiques à reconsidérer les choix imposés.
Ce qui n'empêche pas ce manifeste d'être tout à fait convaincant, surtout par rapport à l'affirmation primaire et gratuite habituelle qui pose que le caractère démocratique est proportionnel au degré de rationalité d'un système politique. Le lecteur pourra quand même avoir du mal à concevoir cette "rationalité" dont parle l'auteur, qui, dit-elle, n'est pas une instance consensuelle neutre surplombant tout le reste, et qui est encore moins cette "instance oraculaire qui prétend faire parler raison à la nature" comme disait M. de Diéguez. Il s'agit en fait de comprendre autrement la rationalité, par "un nouvel usage de la raison" dont elle a traité dans un livre précédent (L'invention des sciences modernes, 1993), qui est plutôt une recherche d'intelligibilité par une pratique dialectique face à des contraintes multiples qu'un quelconque exercice de la raison.
L'image que les sciences donnent d'elles-mêmes est épinglé au passage (l'enseignement, tout entier axé sur la science "faite", reste dogmatique), ainsi que les "pédagogues" qui prétendent légiférer sur la relation singulière maître-élève. Le livre est annoncé comme "labyrinthique". Il contient en effet de nombreux renvois qui lui permettent de fonctionner un peu à la manière d'un "hypertexte". La clarté et la fluidité du style et... sa faible épaisseur dont qu'il se lit quand même très bien, mais de préférence d'une seule traite ! On en retiendra sans doute une idée forte : si on a pu dire que la démocratie est le plus mauvais système de gouvernement à l'exception de tous les autres, on peut aussi penser que la science est le plus mauvais moyen d'élaborer nos connaissances à l'exception de tous les autres...
Maurice Pasdeloup
Fiche mise en ligne le 12/02/2003