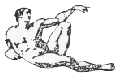| Rédigée par J.L. Le Moigne sur l'ouvrage de ADAM Michel : |
| « LES SCHEMAS, un langage transdisciplinaire. Les comprendre, les réussir » Ed. L'Harmattan, Paris, 1999, ISBN 2-7384-8641-X, 219 pages |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
Michel Adam, qui anime aujourd'hui l'Atelier MCX 9 "Représentation du Travail et Complexité de l'Organisation", vient de publier cet ouvrage sur le langage des schémas, formé dans son expérience d'ingénieur et de formateur. On reprend ici le texte de la préface, qu'a rédigée J.L. Le Moigne, qui donnera aux lecteurs attentifs quelques repères pour aborder cet exercice pratique de modélisation. NDLR
" Le disegno est d’une excellence telle qu’il ne fait pas que montrer les œuvres de la nature, mais qu’il en produit des formes infiniment plus variées... Il surpasse la nature parce que les formes élémentaires de la nature sont limitées, tandis que les œuvres que l’œil exige des mains de l’homme sont illimitées... " (Léonard de Vinci, Cahiers, CU.f., 502, 1162).
Le " disegno ", pour Léonard, est le " dessin à dessein ", la représentation intentionnelle, par la médiation de ces opérateurs artefacts que sont les systèmes de symboles, " de ces œuvres que l’œil exige des mains de l’homme ". Le disegno, outil puissant, à la fois mystérieux et familier dont Léonard nous a donné tant d’étonnantes démonstrations : cinq siècles plus tard, ne nous suffit-il pas de tourner quelques pages de ses " Cahiers " pour nous en convaincre ?
Que notre dessein soit mimétique (re-produire les formes perçues des " œuvres de la nature ") ou poïétique (produire des formes conçues " infiniment plus variées que celles de la nature "), le disegno, le dessin, qu’il soit scriptural ou calligraphique, croquis ou schéma, peut nous permettre de nous le présenter par cet acte complexe que nous appelons la représentation.
Acte complexe que nulle collection de normes (écritures et syntaxes, idéogrammes et icônes...) ne parvient à décrire totalement et définitivement : l’esprit et la main de l’homme toujours sauront, " sans limite " concevoir et comprendre quelque nouvelle opération formée et formante (ou quelques nouveaux symboles et systèmes de symboles) pour représenter et se représenter l’intention ou le projet qui l’anime.
Puisque la langue française n’a pas encore su s’approprier le mot " disegno " pour nous faire entendre et comprendre cette complexité de la représentation intentionnelle (pas plus qu’elle n’a su s’approprier son compère, " l’ingegno ", qui dit la complexité de la conception ingénieuse : G. Vico s’en étonnait déjà il y a près de trois siècles !) , usons donc du mot " représentation " qui nous ouvrira ici les portes du schéma sans le réduire au schématisme. " Le concept de représentation, nous rappelle J. Ladrière dans un article qui est devenu un classique (" Représentation et Connaissance ", Encyclopœdia Universalis, 19 p. 822), repose sur une double métaphore, celle de la représentation théâtrale et celle de la représentation diplomatique ". Dualité qui exprime bien sa complexité à la fois familière et souvent oubliée dans nos enseignements et nos traités, qu’ils soient juridiques ou scientifiques !
La représentation est une opération, processus inséparable des produits qu’elle engendre, les descriptions, et les systèmes de symboles qui l’expriment sont opérandes auto producteurs d’eux-mêmes, récursivement, et d’autres symboles, transitivement.
Le logicien classique, qui ne veut connaître qu’un alphabet fini et fermé, frémit devant cette complexité formelle, mais le spectateur qui assiste à cette représentation théâtrale d’une œuvre déjà souvent représentée, la tient pour familière et même bienvenue ! Il ne veut pas séparer le représentant et le représenté puisqu’il va, à son tour, " se représenter " cette... représentation. Et il a besoin de ce tiers, opérateur de représentation, pour se construire " sa représentation ", celle qui ne prend sens pour lui que lorsqu’il se l’est appropriée. Pour lui, elle n’est pas seulement chose passive (comme est présumée l’être la représentation diplomatique qui voudrait ne pas laisser corrompre le message par le médium) ; elle est aussi et d’abord acte, opération, projet de transformation de quelque image, " différence qui forme une différence " dira G. Bateson (" Vers une écologie de l’esprit ", tome 1, 1972 p. 231), forme élaborée intentionnellement qui transformera peut-être son " image du monde " par laquelle K. Boulding proposait de désigner nos connaissances : " puisque je connais plus que je ne peux voir " (" The Image ", 1956, p. 5).
Ces réflexions sur l’intelligible complexité de " la représentation pour comprendre " nous introduisent aux questions pragmatiques que nous propose ici le travail de Michel Adam, riche d’une grande expérience et d’une longue méditation sur cette expérience. " Représenter pour comprendre ", n’est-ce pas d’abord " comprendre la représentation ", cet acte complexe auquel nous accédons plus aisément par ses résultats, tout en sachant que ce produit ne nous sera intelligible que si nous pouvons le re-produire, nous le représenter. Exercice qu’il n’est guère aisé de décrire s’il est aisé de l’effectuer, mais que l’on peut grandement faciliter en se dotant des outils cognitifs et manuels qu’a peu à peu formés, au fil des siècles l’étonnante expérience modélisatrice de l’humanité.
De cette expérience, Michel Adam retient ici le volet souvent le moins exploré par nos systèmes d’enseignement, celui de la représentation par les dessins et plus directement par les schémas. Le dessin est souvent devenu une discipline, tenue pour mineure certes dans nos écoles, mais qui veille à conserver son pré carré !, alors que le schéma appartient à toutes les disciplines ! : nul n’en revendique l’exclusive propriété peut-être parce que chacun craint son manque d’expérience et de connaissance dans le domaine. On apprend à écrire et même à dessiner, mais apprend-t-on à schématiser pour comprendre et faire comprendre ?
Il y a peut-être depuis Gutenberg, une raison technique à cette curieuse carence, qui s’ajoute aux raisons culturelles que l’on évoque habituellement, liées au quasi monopole du discours logique que le rationalisme cartésien a fait peser sur l’enseignement des modes de compréhension en Occident : L’impression des textes fut jusqu’à il y a peu, beaucoup plus aisée que l’impression des schémas et dessins. Les planches de l’Encyclopédie de Diderot représentèrent longtemps une entreprise fort luxueuse, et aujourd’hui encore les éditeurs français hésitent à publier les " Cahiers de Léonard de Vinci " en version intégrale, sous le prétexte que l’impression de ces milliers de merveilleux schémas et dessins, qui prennent sens à coté des textes qu’ils accompagnaient et qui les accompagnaient dans le texte original, serait trop onéreuse. Et comme les lecteurs n’étaient pas accoutumés à comprendre autrement que par une représentation discursive (ou textuelle), on présumait qu’ils ne sauraient pas se servir de ces autres outils de représentation que sont les schématisations graphiques et picturales.
L’essor contemporain des nouvelles techniques (hypermédia, reprographie couleur...) transforme certes aujourd’hui complètement le poids de cette contrainte technique et économique, mais les habitudes des enseignants et des " représentants " ne se transforment pas aussi vite ; sans doute parce qu’ils persistent à ne voir dans ces outils que des compléments accessoires à nos modes de représentation, sans convenir volontiers de la fascinante complexité des processus cognitifs par lesquels la forme se fait sens en se faisant opération, qui à son tour, récursivement, forme...
La réduction apparente de cette complexité que permettait le mode de présentation linéaire du texte (que l’on paye au prix d’un volume considérable d’informations à traiter : n’est-ce pas pour cela que nos livres s’appellent des "volumes " ?) nous faisait souvent perdre l’intelligence de cette récursivité cognitive familière et inavouée : en m’informant, je me forme, et en me formant, je me transforme transformant ainsi l’information qui me formait ! Nous sera-t-il longtemps difficile de convenir que nous disposons aussi de modes de représentations réticulaires (en réseaux de relation), que les schémas permettent si aisément de rendre accessibles ? Ce le fut, mais je crois que cela ne l’est plus guère ni techniquement, ni culturellement, surtout si nous nous efforçons à cette ascèse épistémologique que requiert (ou que devrait requérir) toute action de représentation et a fortiori d’auto-représentation de perceptions ou de connaissances par des systèmes symboliques.
Une remarquable étude de H.A. Simon et de J. Larkin, publiée en 1987 nous invitait déjà à nous poser cette question apparemment banale : " comment se fait-il qu’un modeste schéma nous en dise souvent plus qu’un long discours? ", en s’étonnant du fait que nous ne sachions pas encore y répondre alors que chacun rappelle volontiers cette observation d’expérience familière. Je ne développe pas ici les premiers éléments de réponse qu’ils apportent à cette interrogation sinon pour souligner l’un des arguments pivot : c’est plus l’organisation interne de la représentation que son volume ou son ampleur qui nous aide à raisonner sur les informations qu’elle nous apporte ; et curieusement, nous ne savons pas encore bien dire comment nous raisonnons sur un schéma de type réticulaire alors que nous savons fort bien dire comment nous raisonnons ou devrions raisonner (logiquement : en traitant le " logos " !) sur un texte de type linéaire, non illustré !
Ils illustrent ceci en s’aidant en particulier de l’activité cognitive en jeu dans la résolution de problèmes scolaire classiques, selon les " représentations " facilitant ou non sa schématisation réticulaire ou picturale. Nous ne savons pas encore bien dire, mais nous savons faire ! Je ne peux ici qu’évoquer la thèse de la schématisation textuelle introduite par J.B. Grize mettant en forme enseignable ces modes de raisonnement qu’il propose d’appeler " logique naturelle ", pour suggérer l’exploration d’une veine qui n’a encore été que peu explorée, nous rappellent H.A. Simon et J. Larkin, celle du "raisonnement sur et par les schémas ". P. Valéry s’y exerçait parfois, en reprenant la première " Introduction à la méthode de Léonard de Vinci " qu’il publiait en 1895.
Fort pragmatiquement, Michel Adam aborde ici la question par le commencement : " voyons comment nous savons aujourd’hui établir des schémas sur lesquels on puisse effectivement raisonner et s’en déclarer souvent satisfait dans tel ou tel contexte ". Le " comment on a fait jusqu’ici ? " précède le " comment pourrait-on aussi faire ? " pour nous inciter à nous interroger, " chemin faisant " sur les multiples pourquoi possibles de ces comment. " Réussir un schéma " c’est plus comprendre et faire comprendre ce que l’on voulait faire par la médiation contingente de ce schéma, que comprendre comment on fait un beau schéma conforme à quelques canons académiques.
Ces interrogations téléologiques sur les fins que suggèrent ces moyens, engendrent des interrogations méthodologiques sur les autres moyens que suggèrent ces fins, lesquelles, à leur tour. Spirale infinie et sans cesse re-parcourue dans laquelle pourra entrer le lecteur constatant aisément, par les nombreuses et plaisantes illustrations de ce livre " les limites des schémas " et surtout les présupposés idéologiques souvent très prégnants (" la pensée de son auteur " dit M. Adam, mais aussi la culture de son lecteur !) que véhiculent nombre de ceux que nous utilisons couramment aujourd’hui pour comprendre et faire comprendre.
Peut-on, à l’expérience mentionner deux de ces présupposés que l’on retrouve trop souvent dans les médias comme dans l’enseignement : celui du primat de la simplicité et celui du primat de la fermeture (ou de l’exclusion) ?
Celui de la simplicité est sans doute le plus universellement accepté : " Pour que l’autre comprenne, il faut faire simple " dit l’un qui s’indigne de l’attitude de l’expert qui proclame : " pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?". Le simple n’est-il pas le nom de l’évidence cartésienne, du " clair et distinct en mon esprit " (en mon esprit, mais dans le vôtre ?) ? Et comme la chose ou l’objet, invariant et aisément identifiable, est plus reconnu et nommé que l’action ou l’opération, changeante et aux multiples facettes, on préférera souvent modéliser (ou schématiser) l’anatomie plutôt que la physiologie, l’organe plutôt que la fonction, l’objet plutôt que le processus, la méthode plutôt que le projet. Les premiers ne se schématisent-ils pas plus " simplement " que les seconds ? : cercles ou patates suffisent à désigner un substantif (ensemble ou un objet, qu’il soit Homme ou Machine !), alors que le verbe ou la fonction demanderont une " boîte noire " désignant à la fois son contexte, son projet, ces activités et ses transformations, boîte noire qu’il faudra relier, ad infinitum à d’autres boîtes noires. Léonard de Vinci avait perçu avec une grande acuité la mutilation qu’allait imposer le critère réducteur du " clair et net " que le " Discours de la Méthode " allait imposer à la culture Occidentale pendant trois siècles. Mais nous tardons à nous inspirer de la technique du " clair-obscur ", le " sfumato " qu’il élabora pour rendre compte fort intelligiblement de toute perception comme de toute conception. Pourrait-on voir sans ombre ? Le grand héron le sait qui ouvre ses ailes sur l’eau pour que leur ombre lui permette de mieux voir le poisson. Pourquoi nos schémas devraient-ils nous priver de cette richesse et de cette ambiguïté de nos perceptions ? Le clair-obscur qui relie n’est-il pas aussi simple à comprendre que le trait clair-et-net qui sépare ?
Le critère de la fermeture est en revanche très généralement non pas récusé mais regretté. Si nous pouvions, nous nous en passerions, mais hélas, nous ne pouvons faire autrement que " de procéder à des dénombrements si entiers que l’on soit assuré de ne rien omettre ", comme nous y invite le quatrième précepte du Discours de la Méthode, avec lequel nous sommes toujours en infraction puisque l’on est assuré de toujours omettre quelque composant peut-être important dans la composition de nos modèles ! L’affaire sera sans gravité épistémologique si nous veillions à maintenir toujours nos modèles ou schémas " ouverts " en symbolisant par quelques processeurs quasi opaques encore les relations spatiales et temporelles que le projet modélisé assure avec le " reste du monde ". Ce faisant, nous nous priverions il est vrai, de toute certitude quant aux interprétations que nous proposerons de ce ou de ces schémas. Modestie difficile pour qui, par son schéma veut convaincre qu’il a nécessairement raison. Que l’on examine la plupart des schémas que rappelle M. Adam, et en particulier ceux qui rendent compte de phénomènes économiques : on verra qu’ils sont presque toujours " fermés ". Rien n’y peut entrer ou sortir qui ne soit déjà inclus dans le modèle. Comment, les interprétant en vue de quelque action intentionnelle, pourrions-nous leur demander de nous aider à anticiper ces effets pervers que nous appréhendons alors qu’à notre insu, nous les avons déjà exclus ?
Cette demande implicite de fermeture repose incidemment sur un autre desiderata universellement tenu pour légitime : celui de la " cohérence " du modèle. Cohérence rassurante, qui permet de récuser bien des objections puisqu’elle postule son unicité : si ce n’est pas cohérent, c’est incohérent ! Cohérence illusoire pourtant et souvent dangereuse qui ignore qu’il est de multiples formes cohérentes possibles dans les affaires humaines, lesquelles au demeurant ne sont jamais parfaitement cohérentes. C’est de cohésion (l’action de cohérer) ou de " congruence " dont nous devrions parler, en nous interrogeant sur les processus de maintenance téléologiques du projet ou du phénomène modélisé : si nos schémas n’en rendent pas compte, en serons-nous conscients lorsque nous les interpréterons ? Philippe Boudon, le père de l’architecturologie, auquel Michel Adam fait quelques très heureux emprunts, rappelle souvent qu’un " dessin " s’interprète au regard de multiples " échelles ", dans le langage de l’architecte ; et conclut-il " cette interrogation mène bien au-delà du domaine propre à l’architecture " (" De l’architecture à l’architecturologie, la question de l’échelle ", PUF 1991)
Pour avoir ignoré cette intelligible complexité de la multiplicité des échelles ou des types de cohérences, n’avons-nous pas souvent oublié le projet qui justifiait notre quête d’intelligibilité. Un riche entendement de nos modes de représentation par dessins, modèles et schémas peut aujourd’hui nous aider à restaurer notre intelligence modélisatrice, en nous rappelant que nous sommes indignes de prescrire si nous ne pouvons et ne savons d’abord décrire ? " Décrire et schématiser pour comprendre ", ce projet que Michel Adam nous invite ici à méditer autant qu’à pratiquer ne mérite t il pas notre attention épistémique autant que pragmatique ? Sachons-lui gré de l’aide qu’ainsi il nous apporte, et accompagnons le dans la poursuite de cette entreprise : il s’agit d’inventer, suggérait déjà Paul Valéry, des nombres plus subtils (qu’il notait " N+S ") pour nous représenter l’infinie diversité " des œuvres que l’œil exige des mains de l’homme ".
J.L. Le Moigne
Fiche mise en ligne le 12/02/2003