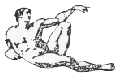| Rédigée par JLM sur l'ouvrage de HEURGON Edith & Josée LANDRIEU, coord. : |
| « Prospective pour une gouvernance démocratique " (Colloque de Cerisy, 1999) » Editions de l’Aube, (84240), 2000, ISBN 2-87678-540-4, 382 pages. |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
Ce n’est pas seulement parce qu’ils sont publiés par le même éditeur et qu’ils traitent de questions fort connexes, que l’on associe ces trois ouvrages dans cette note de lecture : un gros pavé rassemblant une quarantaine de contributions, et deux brochures qui enrichissent la vivante Collection " Société et Territoire ". La conjonction de leurs problématiques, autour des mêmes mots-clefs, Prospective, Aménagement et Urbanisme, Gouvernance, Action collective…, problématique que le Centre Culturel de Cerisy s’attache à promouvoir dans nos cultures depuis plusieurs années, incite aussi à les conjoindre.
Que cette problématique mobilise toujours les mêmes experts en prospective dont on lit les mêmes articles depuis trente ans ne surprendra guère : Edith Heurgon parvient à résumer en une introduction d’une dizaine de pages l’essentiel de leurs propos habituels sur la prospective et la stratégie, tout en suggérant, au conditionnel, les voies d’un renouvellement qui lui semble se manifester : " A une prospective fondée sur l’extrapolation de tendances, positionnée en amont de la décision publique, se substituerait une prospective continue et interactive, apport de connaissance et gestionnaire d’incertitude ( ?) , stimulant un processus d’intelligence collective… " (p.5). Dans cette veine on trouvera en effet quelques arguments renouvelant le discours sur la Gouvernance tel que celui de " l’action collective " proposé par A. Hatchuel (" … afin de cacher de vieilles antinomies sous des noms modernes ", p.29) ou celui d ‘ "économie du lien " proposé par Josée Landrieu (" … plusieurs formes économiques devraient pouvoir coexister et entretenir des liens dynamiques entre elles " in L. Van Eeckhout, p.99). Les lecteurs familiers des activités de l’Atelier MCX " Prospective et Complexité " qu’anime P. Gonod ne seront pas surpris par cette conception d’une prospective devenant " un art de l’étonnement… qui ne craint même pas les liens entre la prospective, la poésie, l’art ou la relation amoureuse " (J. Landrieu, p. 376-377).
Mais on n’est pas certain que ces propos aient convaincu les hommes d’entreprise qui participaient à ce colloque : l’un d’entre eux ne souligne-t-il pas : " Il n’y a pas de prospective sans formalisation : il faut… être sérieux. France Télécom comporte 800 polytechniciens. On ne peut faire de la poésie en disant que c’est de la prospective. Donc tout est quantifié " (p.153). Comment entendra-t-il alors la conclusion que J. Landrieu propose en guise de nouvelle voie pour la prospective ? :
" Mais peut-être la prospective n’est-elle pas seulement la complice du décideur, du " pilote dans l’avion " ? Sans doute faut-il des pilotes éclairés, mais ne faut-il pas aussi que l’ensemble d’une entreprise – les salariés, les syndicats, les clients, les usagers, les actionnaires – pensent et produisent collectivement le changement ? … les projets dans lesquels ils vont s’engager ? La prospective ne serait donc pas une "prospective du prince, mais une prospective de l’être collectif. Avec pour mission de formuler l’objet de son action et non de détecter la "solution optimale". Pourquoi ? Qu’est ce que nous cherchons ? Quel est le sens de notre action ? Ce sont des questions bien plus importantes que "qu’est-ce que nous décidons ?"… " (p.377).
En lisant ces lignes je me souvenais de l’invitation que proposait déjà Pierre Calame il y a trois ans (Dans " L’Etat au cœur ", Desclée de Brouwer, 1977), dans un chapitre qu’il intitulait " Les lieux d’élucidation des enjeux collectifs " (p.68+). N’est-ce pas cela que pourrait être une prospective et une gouvernance entendues dans leur intelligible complexité : P. Calame intitulait significativement son chapitre suivant " Vers une éthique de l’intelligibilité ". L’invention, ou l’ingénierie de ces " lieux d’élucidation des enjeux collectifs reste encore à poursuivre, ces ouvrages récents en témoignent : même les exemples que citait P. Calame ne semblent pas encore familiers : nos experts en prospective n’avaient pas encore appris à inventer " des lieux d’élucidation des enjeux collectifs "… au sein desquels se formeraient des projets dont ils ne pourraient plus s’attribuer la paternité ! Reprenant la solide conclusion de cette " Prospective pour une gouvernance démocratique " que leur propose E. Heurgon et J. Landrieu, vont-ils franchir enfin le Rubicon épistémique qui sépare l’expert et le citoyen ? On peut rêver…
Il faudrait pour cela qu’ils soient plus attentifs à " cette émerveillante capacité de l’esprit humain ", qui est de contextualiser ce que nous percevons, et ainsi de comprendre l’autre ". Nos cultures depuis trop longtemps nous incitent à réduire le moralement bon au syllogistiquement vrai, appauvrissant " notre ingenium, cette faculté qui a été donnée aux humains pour comprendre c’est-à-dire pour faire ". N’est-il pas regrettable que manque à ce gros ouvrage (" faute d’avoir été remis à temps ") l’article de R. Laufer, qui " affirme que " la prospective devient une rhétorique ", alors que sont en crise les deux fondements de l’action collective (le droit et la science) et que s’effondrent les systèmes de légitimité " (p.8) ?
JLM.
Fiche mise en ligne le 12/02/2003