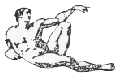Note de lecture
| Rédigée par A. Demailly sur l'ouvrage de SARIN Elysée : |
| « « Introduction conceptuelle à la science des organisations » » L’Harmattan (Questions contemporaines), 2003, ISBN 2-7475-5528-3, 348 pages. |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
Si vous appréciez les vertus de la douche écossaise ou du sauna, vous éprouverez les mêmes sensations vivifiantes en lisant cet ouvrage… à condition d'accepter la dure alternance du chaud et du froid sur la peau de vos convictions !
Disons-le tout de suite, l'académisme de son titre n'incite guère à ce genre d'effort et brouille même les pistes. Il rappelle cependant qu'il s'agit d'une thèse soutenue en 1996 et que l'auteur tenait à y afficher ses positions épistémologiques (sur lesquelles nous reviendrons à la fin de cette note). Un titre tel que " Les conditions d'un (bon) fonctionnement des entreprises " nous semblerait refléter plus fidèlement le contenu de cet ouvrage et la singularité de son auteur : 1) salarié dans le secteur privé et responsable syndical depuis plus de 30 ans ; 2) chercheur à (tous) ses moments perdus et " par vocation ", échappant dès lors aux cloisonnements disciplinaires et autres travers des chercheurs à plein temps ; 3) usager assidu des bibliothèques pour y consulter ce qui a été réellement dit par les penseurs qu'il juge dignes de ce nom.
Pour lui, la science ne peut progresser en ce domaine qu'en se fondant sur ce qu'il y a de " bien établi " : ce qui résiste le mieux à l'épreuve du temps tant en ce qui concerne l'homme que les organisations qu'il a construites. Dès lors, il s'agit de faire le tri entre ce qui relève du mythe et des faits. Et la douche écossaise commence, mettant à mal nos repères et nos idoles…. ou réhabilitant au contraire des idées ou des auteurs que nous avions mis à l'index (par paresse, crédulité ou fascination pour de belles théories qui les avaient massacrés)…
Du coté des recalés, on trouve ainsi pêle-mêle le libéralisme économique (mais pas le modèle de l'homo œconomicus), le courant des relations humaines et la psychologisation des relations de travail, la sociologie durkheimienne et l'idéologie marxiste, le structuralisme et tous les tenants d'une vision figée ou caricaturale des processus organisationnels… Du côté des élus, figurent le libéralisme politique et le droit ainsi que tous les tenants d'une vision pragmatique des rapports humains, à commencer par Pierre Joseph Proudhon (pour son refus de l'arbitraire et sa défense du droit), Chester Barnard (pour sa définition de l'organisation comme " association d'efforts coopératifs ") ainsi que certains psychanalystes tels que Legendre et Pommier (pour leur mise à nu des ressorts de toute manipulation)… Au milieu du gué, on trouve Taylor, Ford et les entreprises allemandes ou japonaises (pour leur perspicacité)…
Au fil de l'ouvrage, tous ces éléments s'agencent en une thèse que l'on résumera comme suit. Toute organisation est un " construit social " qui unit contractuellement des individus terriblement soucieux de leurs intérêts propres (ce qui conforte le modèle de l'homo œconomicus d'Adam Smith). Dès lors, toute organisation humaine a d'abord une dimension politique et ne peut prospérer que dans un contexte de libéralisme politique, respectueux des droits de chacun : droit à l'altérité (contre toute tentative de fusion en classes ou en castes), droit à la liberté (contre les sirènes de l'embrigadement), droit à la propriété (contre les appels à son abandon au profit d'intérêts supérieurs). Dans ces conditions, le libéralisme politique est indissociable du droit qui protège chacun et pacifie les rapports des uns avec les autres.
Ceci vaut tout particulièrement pour les organisations de production qui mettent en rapport des puissants (les patrons) et des faibles (les salariés). Ces derniers ne peuvent être en aucun cas la propriété des premiers mais échangent leur travail contre une juste rémunération et la garantie de la sécurité de leur emploi. Il en résulte une confrontation permanente (où chacun défend ses intérêts) qui appelle périodiquement des négociations qui débouchent toujours sur des compromis. Ce qui sous-entend que ces conflits d'intérêts ne peuvent jamais être considérés comme des jeux à somme nulle ou des batailles décisives (avec un perdant et un gagnant) mais toujours comme des jeux à somme non nulle ou des étapes fécondes d'un cheminement collectif (dont tout le monde sort gagnant). Ainsi, la vie en entreprise peut être considérée comme un projet entrepreneurial commun où les objectifs des uns (productivité, qualité, développement et prospérité) ne peuvent être atteints qu'à la condition de répondre aux aspirations des autres (notamment en termes de rémunération et de sécurité de l'emploi).
Malheureusement, cette vision dynamique des processus organisationnels (qui est celle de Proudhon ou de Sorel en France mais aussi de Barnard ou de Coase aux Etats-Unis) a été supplantée par d'autres visions dont nous avons toujours à payer les séquelles. Elysée Sarin a le grand mérite de nous éclairer sur les péripéties historiques de leur succès. En ce qui concerne la France, il nous rappelle ainsi que l'échec de la Commune de Paris entraîna l'hécatombe de la fine fleur d'entrepreneurs à la fibre sociale et créa un vide propice à l'émergence de grands cartels et à l'invasion concomitante de la vision marxiste d'une lutte de classes sans merci et d'une histoire finalisée de l'humanité. Il souligne aussi le caractère anti-individualiste et déterministe de la sociologie de Durkheim dont on retrouve actuellement les traces dans les conceptions structuralistes des phénomènes sociaux, telles que l'apologie (par Crozier) des rapports de force et de la conquête des zones d'incertitude (bref, une interminable guerre de tranchées où l'on tire sur tout ce qui dépasse ou qui bouge)…
Au plan mondial, il souligne cependant que la vision la plus pernicieuse émane du libéralisme économique qui est associé à tort au libéralisme politique. Le libéralisme économique repose moins, en effet, sur le modèle de l'homo œconomicus que sur la foi en une équilibration quasi naturelle des transactions (la fameuse " main invisible "). C'est l'apologie du laisser-faire au détriment du droit. Maints chefs d'entreprises s'en réclament pour maximiser leurs profits et ne voir dans leurs employés qu'une ressource parmi d'autres (qu'on embauche et licencie à volonté : " hire and fire "). Ce faisant, ils récoltent ce qu'ils ont semé, sous forme d'actions syndicales aussi barbares que les grèves avec prise d'otages (bref, ils ont les syndicats qu'ils méritent)...
Elysée Sarin s'attaque également à la rémunération différenciée en fonction du " mérite ". En voulant maximiser leurs profits, les chefs d'entreprise se laissent bercer par le mythe de variables psychologiques (besoins à satisfaire, motivation, résistance au changement) qui médiatiseraient le rapport au travail de leurs salariés et qu'il conviendrait de manipuler par le biais de la rémunération. Il montre que de telles pratiques sont vouées à l'échec : non seulement les salariés savent d'expérience qu'elles profitent toujours aux plus gros (les salaires disproportionnés des cadres supérieurs et les " stocks options " des PDG) ou aux plus malins, mais Ford ou Taylor le savaient déjà (l'un en uniformisant les efforts et les salaires par la cadence de la chaîne de montage, l'autre en créant un salaire différentiel qui réduise nettement la tentation du " rendement ").
Symétriquement, notre auteur ne s'abandonne pas pour autant au mythe de l'ouvrier héroïque ou autogestionnaire. Les salariés aspirent simplement à un " bon boulot ", bien rémunéré et pas trop fatiguant ou stressant . Ils savent aussi qu'une entreprise ne peut fonctionner " sans la main invisible " de leur bonne volonté. Chaque fois qu'un patron va dans ce sens, en libérant leurs capacités d'initiative ou en œuvrant en faveur de la sécurité de leur emploi, ils lui renvoient volontiers l'ascenseur (cf. les études de Borzeix, citées pp. 119-120 et 211).
Cerise sur le gâteau, E. Sarin " démonte " en annexe quelques travaux qui ont alimenté ces mythes (l'interprétation biaisée des expériences de la Western Electric, le modèle hiérarchique des besoins de Maslow, le thème racoleur de la " réalisation de soi ", la question de l'autogestion ou encore les dérapages des enquêtes d'opinion).
Cet ouvrage porte donc essentiellement sur le fonctionnement interne des entreprises. On aurait aimé qu'il aborde aussi les rapports de ces organisations avec leur environnement externe, notamment leur environnement scientifique (nouvelles connaissances) et technique (nouvelles machines) qui pèse lourdement sur leur évolution. La vision à dominante proudhonienne de l'auteur l'incite sans doute trop à laisser ces soucis à la partie managériale… et il resterait à démontrer qu'une entreprise dont les rapports internes sont sains (c'est-à-dire constamment négociés) ne peut qu'être plus attentive et imaginative quant à son environnement extérieur… Tous ces aspects délibérément négligés sont davantage explorés par Herbert Simon et l'on regrettera qu'Elysée Sarin n'ait pas lancé plus de ponts en sa direction, alors qu'il l'a présenté comme un allié sur les points qu'il a privilégiés…
On critiquera plus vivement les positions épistémologiques de l'auteur. D'entrée de jeu, celui-ci annonce qu'il entend faire le tri entre des énoncés qui correspondent à la réalité (aux faits) et des énoncés purement mythiques ou fantaisistes sur celle-ci. Il s'agit donc d'un travail d'élimination ou de réfutation que l'on pourrait qualifier de " poppérien ", d'autant plus que Popper s'est livré dans " La société ouverte et ses ennemis " à une critique féroce de quelques auteurs (Platon, Hegel et Marx) peu portés sur l'individu et la démocratie. Pourtant, Elysée Sarin (qui se réfère uniquement à la critique qu'en fait Largeault) enterre illico Popper sous prétexte qu'il cherchait un critère " normatif " de démarcation entre énoncés scientifiques et non scientifiques… ce qui correspond, semble-t-il, assez bien à sa fâcheuse tendance à qualifier élogieusement ou péjorativement tout auteur qui passe ou non au travers de son tamis ! On aurait préféré que Popper fût recalé sous le prétexte qu'il mettait les sciences sociales sur le même pied que les sciences naturelles ou qu'il croyait trop aux vertus de la logique et de la critique rationnelle ! Faute de quoi, notre auteur se rabat sur la valeur des concepts qui peuvent être creux ou pleins (d'où le titre de son ouvrage) sans préciser outre mesure ce qui les rend tels (si ce n'est leur problématique insertion dans une théorie )…
Nous avons donc tenté de remonter aux sources de cette conviction : 1) premier indice, Hegel est qualifié de " prince des auteurs conceptuels " (p. 26) alors qu'il n'est guère épargné dans le reste de l'ouvrage ; 2) deuxième indice, on trouve effectivement cette phrase de Canguilhem (1968, p. 346), auteur qu'il révère visiblement pour avoir été le maître de son maître Robert Pagès : " Un autre passage (de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, p. 60) contient une formule admirable : " Les pensées vraies et la pénétration scientifique peuvent seulement se gagner par le travail du concept. Le concept seul peut produire l'universalité du savoir " " (ce qui revient à dire qu'il n'y a de science que conceptuelle) ; 3) troisième indice, le même Canguilhem (ibid., p. 345) cite sans sourciller cet autre passage de la Phénoménologie de l'Esprit : " La vie est l'unité immédiate du concept à sa réalité, sans que ce concept s'y distingue " (bigre ! le concept serait-il donc déjà dans la vie et la vie dans le concept ? ou la vie serait-elle verbe et structurée à la manière du langage ?). Devant ces vertiges de la pensée philosophique, on peut toutefois se raccrocher à cette phrase plus terre-à-terre de Boltzmann (p. 75) : " Comment éviter que tout au long de l'approfondissement de la théorie, l'image ne passe jamais pour l'Existant ? En ce sens, Hegel, déjà, a dû regretter que la nature n'ait pas pu réaliser dans toute sa perfection son système philosophique ".
Notre auteur serait-il donc plus hégélien que poppérien ? Ce qu'il a fait dans son ouvrage (confronter des montages théoriques aux faits) tendrait à montrer que ce n'est pas le cas… mais ce qu'il dit en préambule de ce qu'il a fait laisserait entendre qu'il s'est laissé séduire, comme tant d'autres en France, par les dévots d'un hégélianisme doctrinaire ! Mais ne gâchons pas notre plaisir. Nous manquons cruellement de ce type d'ouvrages érudits qui relient avec soin le présent au passé, soulignant d'autant plus vigoureusement notre tendance à récidiver dans l'échec ou à préférer les feux éphémères de la rampe médiatique aux trésors cachés des bibliothèques (autre thème cher à Popper !)…
Pour terminer, citons, toujours pour le plaisir, quelques conclusions d'un texte inédit de Proudhon déniché par notre auteur (p. 54) : " 1) Les intérêts consacrés par la société sont mobiles, sujets à un déplacement continu et essentiellement instables ; 2) La fixité, la permanence ou perpétuité des rapports d'intérêts est une chimère ; 3) Cette mobilité des intérêts est la première source des révolutions ; 7) Le culte de la vérité pour elle-même est pur non-sens en révolution ; 8) Toute la religion, toutes les institutions politiques, toute l'économie de la société sont des modifications successives du cannibalisme ; 9) Les idées qui, avec les intérêts gouvernent la société, sont mobiles comme ces mêmes intérêts, susceptibles de plus et de moins, sujettes par nature à opposition, contradiction, et perpétuellement altérées ; 10) La constance dans les idées est le contraire de l'Esprit social ; l'immutabilité des symboles et des professions de foi, dans la société, est une chimère ; 11) Cette oscillation essentielle des idées est la seconde cause des révolutions. "
(1) Cf. p. 12 : " Réappréciant alors les matériaux que ces disciplines avaient accumulés pour n'en retenir que les faits bien établis, il nous apparut que le terrain de la connaissance se stabilisait et prenait forme, qu'il s'en dégageait une représentation du travailleur salarié suffisamment univoque et pénétrante pour rendre compte des faits observés dans les organisations de production, et même réévaluer par surcroît un certain nombre d'événements historiques d'importance, dogmatiquement traités par les auteurs académi-ques ".
(2) Cf. p. 16 : " L'histoire est le bilan (euristique) de la connaissance et de l'expérience du passé - c'est à dire notamment de nos illusions et de nos erreurs - et de leur mise à l'épreuve dans le temps ".
(3) Qu'il considère comme le " vrai père de la science des organisations ".
(4) Par ailleurs, éminent juriste et spécialiste du droit romain.
(5) Cf. pp. 79-80.
(6) On ne peut s'empêcher de s'interroger toutefois sur ce que les salariés mettent " après leur vie de boulot " et s'il ne s'agit pas d'une " retraite de rêve " où ils feraient tout ce qu'ils n'ont pu faire (alors qu'ils continueront de faire ce qu'ils ont toujours fait)… Dans ces conditions, la retraite ne serait-elle pas un avatar du paradis, tout aussi fantasmatique que celui-ci, à moins de s'y préparer par quelque initiation à la découverte de soi ou au renoncement ?
(7) Reproche que nous ferions à Popper mais que Sarin ne lui fait en aucun cas puisqu'il estime lui-même qu'il y a continuité entre sciences de la nature et sciences sociale (cf. page 180, note 2).
(8) Cf. p. 41 : " Un concept se stabilise enfin rigoureusement lorsqu'il prend sens dans un cadre d'interprétation théorique ".
(9) Canguilhem, G. (1968). " La nouvelle connaissance de la vie, le concept et la vie ", pp. 335-364, in : Etudes d'histoire et de philosophie des sciences. Paris, J. Vrin, 1989.
(10) Boltzmann, L. (1905). Voyage d'un professeur allemand en Eldorado et autres écrits populaires. Actes Sud, 1987.
(11) Popper K. (1972). " Une épistémologie sans sujet connaissant ", pp. 119-164, in : La connaissance objective. Bruxelles, Editions Complexes, 1978.
(12) Cours d'économie. Propositions nouvelles démontrées dans la pratique des révolutions (1851, p. 238).
Disons-le tout de suite, l'académisme de son titre n'incite guère à ce genre d'effort et brouille même les pistes. Il rappelle cependant qu'il s'agit d'une thèse soutenue en 1996 et que l'auteur tenait à y afficher ses positions épistémologiques (sur lesquelles nous reviendrons à la fin de cette note). Un titre tel que " Les conditions d'un (bon) fonctionnement des entreprises " nous semblerait refléter plus fidèlement le contenu de cet ouvrage et la singularité de son auteur : 1) salarié dans le secteur privé et responsable syndical depuis plus de 30 ans ; 2) chercheur à (tous) ses moments perdus et " par vocation ", échappant dès lors aux cloisonnements disciplinaires et autres travers des chercheurs à plein temps ; 3) usager assidu des bibliothèques pour y consulter ce qui a été réellement dit par les penseurs qu'il juge dignes de ce nom.
Pour lui, la science ne peut progresser en ce domaine qu'en se fondant sur ce qu'il y a de " bien établi " : ce qui résiste le mieux à l'épreuve du temps tant en ce qui concerne l'homme que les organisations qu'il a construites. Dès lors, il s'agit de faire le tri entre ce qui relève du mythe et des faits. Et la douche écossaise commence, mettant à mal nos repères et nos idoles…. ou réhabilitant au contraire des idées ou des auteurs que nous avions mis à l'index (par paresse, crédulité ou fascination pour de belles théories qui les avaient massacrés)…
Du coté des recalés, on trouve ainsi pêle-mêle le libéralisme économique (mais pas le modèle de l'homo œconomicus), le courant des relations humaines et la psychologisation des relations de travail, la sociologie durkheimienne et l'idéologie marxiste, le structuralisme et tous les tenants d'une vision figée ou caricaturale des processus organisationnels… Du côté des élus, figurent le libéralisme politique et le droit ainsi que tous les tenants d'une vision pragmatique des rapports humains, à commencer par Pierre Joseph Proudhon (pour son refus de l'arbitraire et sa défense du droit), Chester Barnard (pour sa définition de l'organisation comme " association d'efforts coopératifs ") ainsi que certains psychanalystes tels que Legendre et Pommier (pour leur mise à nu des ressorts de toute manipulation)… Au milieu du gué, on trouve Taylor, Ford et les entreprises allemandes ou japonaises (pour leur perspicacité)…
Au fil de l'ouvrage, tous ces éléments s'agencent en une thèse que l'on résumera comme suit. Toute organisation est un " construit social " qui unit contractuellement des individus terriblement soucieux de leurs intérêts propres (ce qui conforte le modèle de l'homo œconomicus d'Adam Smith). Dès lors, toute organisation humaine a d'abord une dimension politique et ne peut prospérer que dans un contexte de libéralisme politique, respectueux des droits de chacun : droit à l'altérité (contre toute tentative de fusion en classes ou en castes), droit à la liberté (contre les sirènes de l'embrigadement), droit à la propriété (contre les appels à son abandon au profit d'intérêts supérieurs). Dans ces conditions, le libéralisme politique est indissociable du droit qui protège chacun et pacifie les rapports des uns avec les autres.
Ceci vaut tout particulièrement pour les organisations de production qui mettent en rapport des puissants (les patrons) et des faibles (les salariés). Ces derniers ne peuvent être en aucun cas la propriété des premiers mais échangent leur travail contre une juste rémunération et la garantie de la sécurité de leur emploi. Il en résulte une confrontation permanente (où chacun défend ses intérêts) qui appelle périodiquement des négociations qui débouchent toujours sur des compromis. Ce qui sous-entend que ces conflits d'intérêts ne peuvent jamais être considérés comme des jeux à somme nulle ou des batailles décisives (avec un perdant et un gagnant) mais toujours comme des jeux à somme non nulle ou des étapes fécondes d'un cheminement collectif (dont tout le monde sort gagnant). Ainsi, la vie en entreprise peut être considérée comme un projet entrepreneurial commun où les objectifs des uns (productivité, qualité, développement et prospérité) ne peuvent être atteints qu'à la condition de répondre aux aspirations des autres (notamment en termes de rémunération et de sécurité de l'emploi).
Malheureusement, cette vision dynamique des processus organisationnels (qui est celle de Proudhon ou de Sorel en France mais aussi de Barnard ou de Coase aux Etats-Unis) a été supplantée par d'autres visions dont nous avons toujours à payer les séquelles. Elysée Sarin a le grand mérite de nous éclairer sur les péripéties historiques de leur succès. En ce qui concerne la France, il nous rappelle ainsi que l'échec de la Commune de Paris entraîna l'hécatombe de la fine fleur d'entrepreneurs à la fibre sociale et créa un vide propice à l'émergence de grands cartels et à l'invasion concomitante de la vision marxiste d'une lutte de classes sans merci et d'une histoire finalisée de l'humanité. Il souligne aussi le caractère anti-individualiste et déterministe de la sociologie de Durkheim dont on retrouve actuellement les traces dans les conceptions structuralistes des phénomènes sociaux, telles que l'apologie (par Crozier) des rapports de force et de la conquête des zones d'incertitude (bref, une interminable guerre de tranchées où l'on tire sur tout ce qui dépasse ou qui bouge)…
Au plan mondial, il souligne cependant que la vision la plus pernicieuse émane du libéralisme économique qui est associé à tort au libéralisme politique. Le libéralisme économique repose moins, en effet, sur le modèle de l'homo œconomicus que sur la foi en une équilibration quasi naturelle des transactions (la fameuse " main invisible "). C'est l'apologie du laisser-faire au détriment du droit. Maints chefs d'entreprises s'en réclament pour maximiser leurs profits et ne voir dans leurs employés qu'une ressource parmi d'autres (qu'on embauche et licencie à volonté : " hire and fire "). Ce faisant, ils récoltent ce qu'ils ont semé, sous forme d'actions syndicales aussi barbares que les grèves avec prise d'otages (bref, ils ont les syndicats qu'ils méritent)...
Elysée Sarin s'attaque également à la rémunération différenciée en fonction du " mérite ". En voulant maximiser leurs profits, les chefs d'entreprise se laissent bercer par le mythe de variables psychologiques (besoins à satisfaire, motivation, résistance au changement) qui médiatiseraient le rapport au travail de leurs salariés et qu'il conviendrait de manipuler par le biais de la rémunération. Il montre que de telles pratiques sont vouées à l'échec : non seulement les salariés savent d'expérience qu'elles profitent toujours aux plus gros (les salaires disproportionnés des cadres supérieurs et les " stocks options " des PDG) ou aux plus malins, mais Ford ou Taylor le savaient déjà (l'un en uniformisant les efforts et les salaires par la cadence de la chaîne de montage, l'autre en créant un salaire différentiel qui réduise nettement la tentation du " rendement ").
Symétriquement, notre auteur ne s'abandonne pas pour autant au mythe de l'ouvrier héroïque ou autogestionnaire. Les salariés aspirent simplement à un " bon boulot ", bien rémunéré et pas trop fatiguant ou stressant . Ils savent aussi qu'une entreprise ne peut fonctionner " sans la main invisible " de leur bonne volonté. Chaque fois qu'un patron va dans ce sens, en libérant leurs capacités d'initiative ou en œuvrant en faveur de la sécurité de leur emploi, ils lui renvoient volontiers l'ascenseur (cf. les études de Borzeix, citées pp. 119-120 et 211).
Cerise sur le gâteau, E. Sarin " démonte " en annexe quelques travaux qui ont alimenté ces mythes (l'interprétation biaisée des expériences de la Western Electric, le modèle hiérarchique des besoins de Maslow, le thème racoleur de la " réalisation de soi ", la question de l'autogestion ou encore les dérapages des enquêtes d'opinion).
Cet ouvrage porte donc essentiellement sur le fonctionnement interne des entreprises. On aurait aimé qu'il aborde aussi les rapports de ces organisations avec leur environnement externe, notamment leur environnement scientifique (nouvelles connaissances) et technique (nouvelles machines) qui pèse lourdement sur leur évolution. La vision à dominante proudhonienne de l'auteur l'incite sans doute trop à laisser ces soucis à la partie managériale… et il resterait à démontrer qu'une entreprise dont les rapports internes sont sains (c'est-à-dire constamment négociés) ne peut qu'être plus attentive et imaginative quant à son environnement extérieur… Tous ces aspects délibérément négligés sont davantage explorés par Herbert Simon et l'on regrettera qu'Elysée Sarin n'ait pas lancé plus de ponts en sa direction, alors qu'il l'a présenté comme un allié sur les points qu'il a privilégiés…
On critiquera plus vivement les positions épistémologiques de l'auteur. D'entrée de jeu, celui-ci annonce qu'il entend faire le tri entre des énoncés qui correspondent à la réalité (aux faits) et des énoncés purement mythiques ou fantaisistes sur celle-ci. Il s'agit donc d'un travail d'élimination ou de réfutation que l'on pourrait qualifier de " poppérien ", d'autant plus que Popper s'est livré dans " La société ouverte et ses ennemis " à une critique féroce de quelques auteurs (Platon, Hegel et Marx) peu portés sur l'individu et la démocratie. Pourtant, Elysée Sarin (qui se réfère uniquement à la critique qu'en fait Largeault) enterre illico Popper sous prétexte qu'il cherchait un critère " normatif " de démarcation entre énoncés scientifiques et non scientifiques… ce qui correspond, semble-t-il, assez bien à sa fâcheuse tendance à qualifier élogieusement ou péjorativement tout auteur qui passe ou non au travers de son tamis ! On aurait préféré que Popper fût recalé sous le prétexte qu'il mettait les sciences sociales sur le même pied que les sciences naturelles ou qu'il croyait trop aux vertus de la logique et de la critique rationnelle ! Faute de quoi, notre auteur se rabat sur la valeur des concepts qui peuvent être creux ou pleins (d'où le titre de son ouvrage) sans préciser outre mesure ce qui les rend tels (si ce n'est leur problématique insertion dans une théorie )…
Nous avons donc tenté de remonter aux sources de cette conviction : 1) premier indice, Hegel est qualifié de " prince des auteurs conceptuels " (p. 26) alors qu'il n'est guère épargné dans le reste de l'ouvrage ; 2) deuxième indice, on trouve effectivement cette phrase de Canguilhem (1968, p. 346), auteur qu'il révère visiblement pour avoir été le maître de son maître Robert Pagès : " Un autre passage (de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, p. 60) contient une formule admirable : " Les pensées vraies et la pénétration scientifique peuvent seulement se gagner par le travail du concept. Le concept seul peut produire l'universalité du savoir " " (ce qui revient à dire qu'il n'y a de science que conceptuelle) ; 3) troisième indice, le même Canguilhem (ibid., p. 345) cite sans sourciller cet autre passage de la Phénoménologie de l'Esprit : " La vie est l'unité immédiate du concept à sa réalité, sans que ce concept s'y distingue " (bigre ! le concept serait-il donc déjà dans la vie et la vie dans le concept ? ou la vie serait-elle verbe et structurée à la manière du langage ?). Devant ces vertiges de la pensée philosophique, on peut toutefois se raccrocher à cette phrase plus terre-à-terre de Boltzmann (p. 75) : " Comment éviter que tout au long de l'approfondissement de la théorie, l'image ne passe jamais pour l'Existant ? En ce sens, Hegel, déjà, a dû regretter que la nature n'ait pas pu réaliser dans toute sa perfection son système philosophique ".
Notre auteur serait-il donc plus hégélien que poppérien ? Ce qu'il a fait dans son ouvrage (confronter des montages théoriques aux faits) tendrait à montrer que ce n'est pas le cas… mais ce qu'il dit en préambule de ce qu'il a fait laisserait entendre qu'il s'est laissé séduire, comme tant d'autres en France, par les dévots d'un hégélianisme doctrinaire ! Mais ne gâchons pas notre plaisir. Nous manquons cruellement de ce type d'ouvrages érudits qui relient avec soin le présent au passé, soulignant d'autant plus vigoureusement notre tendance à récidiver dans l'échec ou à préférer les feux éphémères de la rampe médiatique aux trésors cachés des bibliothèques (autre thème cher à Popper !)…
Pour terminer, citons, toujours pour le plaisir, quelques conclusions d'un texte inédit de Proudhon déniché par notre auteur (p. 54) : " 1) Les intérêts consacrés par la société sont mobiles, sujets à un déplacement continu et essentiellement instables ; 2) La fixité, la permanence ou perpétuité des rapports d'intérêts est une chimère ; 3) Cette mobilité des intérêts est la première source des révolutions ; 7) Le culte de la vérité pour elle-même est pur non-sens en révolution ; 8) Toute la religion, toutes les institutions politiques, toute l'économie de la société sont des modifications successives du cannibalisme ; 9) Les idées qui, avec les intérêts gouvernent la société, sont mobiles comme ces mêmes intérêts, susceptibles de plus et de moins, sujettes par nature à opposition, contradiction, et perpétuellement altérées ; 10) La constance dans les idées est le contraire de l'Esprit social ; l'immutabilité des symboles et des professions de foi, dans la société, est une chimère ; 11) Cette oscillation essentielle des idées est la seconde cause des révolutions. "
(1) Cf. p. 12 : " Réappréciant alors les matériaux que ces disciplines avaient accumulés pour n'en retenir que les faits bien établis, il nous apparut que le terrain de la connaissance se stabilisait et prenait forme, qu'il s'en dégageait une représentation du travailleur salarié suffisamment univoque et pénétrante pour rendre compte des faits observés dans les organisations de production, et même réévaluer par surcroît un certain nombre d'événements historiques d'importance, dogmatiquement traités par les auteurs académi-ques ".
(2) Cf. p. 16 : " L'histoire est le bilan (euristique) de la connaissance et de l'expérience du passé - c'est à dire notamment de nos illusions et de nos erreurs - et de leur mise à l'épreuve dans le temps ".
(3) Qu'il considère comme le " vrai père de la science des organisations ".
(4) Par ailleurs, éminent juriste et spécialiste du droit romain.
(5) Cf. pp. 79-80.
(6) On ne peut s'empêcher de s'interroger toutefois sur ce que les salariés mettent " après leur vie de boulot " et s'il ne s'agit pas d'une " retraite de rêve " où ils feraient tout ce qu'ils n'ont pu faire (alors qu'ils continueront de faire ce qu'ils ont toujours fait)… Dans ces conditions, la retraite ne serait-elle pas un avatar du paradis, tout aussi fantasmatique que celui-ci, à moins de s'y préparer par quelque initiation à la découverte de soi ou au renoncement ?
(7) Reproche que nous ferions à Popper mais que Sarin ne lui fait en aucun cas puisqu'il estime lui-même qu'il y a continuité entre sciences de la nature et sciences sociale (cf. page 180, note 2).
(8) Cf. p. 41 : " Un concept se stabilise enfin rigoureusement lorsqu'il prend sens dans un cadre d'interprétation théorique ".
(9) Canguilhem, G. (1968). " La nouvelle connaissance de la vie, le concept et la vie ", pp. 335-364, in : Etudes d'histoire et de philosophie des sciences. Paris, J. Vrin, 1989.
(10) Boltzmann, L. (1905). Voyage d'un professeur allemand en Eldorado et autres écrits populaires. Actes Sud, 1987.
(11) Popper K. (1972). " Une épistémologie sans sujet connaissant ", pp. 119-164, in : La connaissance objective. Bruxelles, Editions Complexes, 1978.
(12) Cours d'économie. Propositions nouvelles démontrées dans la pratique des révolutions (1851, p. 238).
Fiche mise en ligne le 21/06/2004