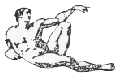| Rédigée par LE MOIGNE Jean-Louis sur l'ouvrage de ALCARAS Jean-Robert & Alii : |
| « DÉCIDER DANS LES ORGANISATIONS : Dialogues critiques entre économie et gestion » (L'Harmattan). ISBN : 2-7475-6066-X • septembre 2004 • 250 pages) |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
Ndlr : En reprenant ici les termes de la préface qu'il a rédigée pour cet ouvrage collectif sur la décision dans les organisations, J.L. Le Moigne espère susciter l'attention d'autres lecteurs qui nous diront peut-être leurs propres méditations sur les dialogues critiques entre économie et gestion auxquels ont voulu s’essayer les auteurs.
____________________________________________________________________________________
Et pourtant, les organisations décident ! L’exercice de la décision relève-t’il d’une formation scientifique, et donc d’un enseignement discipliné ? Élaborer et prendre une décision est un acte cognitif qui implique la recherche et l’examen de quelques connaissances, chacun en convient volontiers, que cet acte soit perçu comme celui d’une personne ou d’une organisation sociale[i]. Mais les connaissances dont on dispose pour identifier le processus de décision lui-même semblèrent longtemps dérisoires ou magiques, réduites aux modèles extrêmes de l’automate calculateur et du génie machiavélique. Pourtant, depuis que l’exercice de la décision dans les organisations humaines est considéré comme devant relever d’une formation scientifique, et donc d’un enseignement discipliné, soit au détour des années cinquante, il fallut recenser ou établir ces connaissances enseignables sous des formes académiquement recevables — condition nécessaire pour « diplômer les décideurs » par un label de qualité analogue à celui que l’on attribue aux architectes, aux médecins ou aux comptables !
Les deux bras des sciences de la décision
C’est dans les années cinquante en effet que se constitue ce corpus disciplinaire que l’on entendra ultérieurement sous le nom de « Sciences de la décision ». Corpus qui s’articula aussitôt en deux bras. Celui des « mathématiques de la décision », construit sur les œuvres de J. von Neumann et O. Morgenstern (Théorie des jeux et comportements économiques), de N. Wiener (Cybernétique, science de la communication et de la commande), d’A. Wald et L. Savage (Fondations des statistiques). Et celui des « sciences de la décision organisationnelle », construit sur les œuvres de H.A. Simon (« Le comportement des organisations » et « The new science of management décision »), de G. Polya et d’A. Newell (« Heuristic programming »), œuvres qui susciteront les développements de l’Intelligence artificielle (« Human problem solving ») et des sciences de la cognition.
Mais au fil du temps, ces deux bras ne s’associèrent pas volontiers, malgré les efforts d’H.A. Simon. Les sciences économiques et de gestion, ravies de la respectabilité académique que leur valait la bannière des « mathématiques de la décision » sous laquelle elles pouvaient se ranger, ne consentirent pas volontiers à s’exercer à leur propre critique épistémologique interne. Attitude bien imprudente au demeurant : si toutes les décisions humaines sont mathématisables, l’économie et la gestion ne deviennent-elles pas des disciplines ancillaires, humbles servantes des prestigieuses mathématiques ?
Incident révélateur de cette fermeture académique, le comportement de la faculté d’économie de l’Université Carnegie Mellon où enseignait H.A. Simon qui, en 1959, invita ce dernier à aller planter sa tente ailleurs. Ce qu’il fit pour continuer à travailler, devenant peu après membre (également éminent) des facultés d’Informatique et de Psychologie de son université, tout en continuant ses recherches en économie et gestion. Recherches qui lui valurent, en 1978, le Prix Nobel d’Economie … pour ses travaux sur les sciences de la décision. A la différence de nombre de ses collègues du « mainstream » des sciences économiques et de gestion, il n’avait cessé de veiller à la critique épistémologique interne de ses propres travaux, conscient du caractère innovant de son regard sur les processus de décision dans les organisations sociales[ii] — elles ne sont pas des ruches d’abeilles soumises exclusivement à quelque algorithmique optimisante, comme le voudraient les économistes maximisateurs d’une bien hypothétique « Utilité Subjective Espérée » !
Ces processus, étudiés empiriquement, sont manifestement irréductibles exclusivement à des formalismes mathématiques analytico-déductifs, et ils sont pourtant manifestement intelligibles pour tout « observacteur » qui s’attache à les décrire en identifiant leurs régularités et leurs singularités. Je crois que c’est dans la « Conférence Nobel de H.A. Simon (« Rational decision making in business organizations ») que l’on trouve les illustrations les plus convaincantes de cet argument.
La vieille tension qui caractérise l’évolution de la science occidentale
Peut-être retrouvons-nous ici une des traces de cette vieille tension qui caractérise l’évolution de la science occidentale depuis trois siècles, entre « l’épistémè platonicienne », en quête d’une vérité désincarnée et voulant ignorer que « l’homme est la mesure de toute chose » (Protagoras), épistémè qui imprègne toujours la culture des académies scientifiques, et la « pragmatiké pyrrhonicienne » qui, avec Montaigne et G. Vico, reconnaît « le véritable dans le faisable » ?
Déployer le superbe éventail de la rationalité
Pourquoi, demandait H.A. Simon, une « épistémologie formelle » (attentive aux seules formes des états ou des objets) devrait elle toujours l’emporter sur une « épistémologie empirique » (attentive d’abord aux processus ou aux actions, « Formes, substances, actions passant sans arrêt l’une dans l’autre », P. Valéry). La rationalité ne se réduit pas aux seuls formalismes du syllogisme déductif parfait que contraint une axiomatique indifférente à « l’essentielle hétérogénéité de l’être », (A. Machado). Son superbe éventail se déploie aisément, révélant les émerveillants et ingénieux détours de l’intelligence humaine.
L’ingenium, cette étrange faculté de l’esprit qui est de relier
« L’Ingenium est cette étrange faculté de l’esprit humain qui est de relier », nous rappelait G. Vico dés 1708, s’étonnant que la langue française soit une des rares langues européennes qui n’ait pas su traduire ce mot latin. Abduction et retroduction récursive ou réflexive, transduction, conduction, induction, rationalité procédurale ou délibérative, rationalité dialectique ou dialogique… les noms par lesquels nous savons désigner les multiples facettes de cet éventail déployant les usages intelligibles de la raison dans les affaires humaines désignent des pratiques cognitives qui nous sont familières dés lors que nous cherchons à « comprendre pour faire et à faire pour comprendre ». Pourquoi faudrait-il toujours refermer cet éventail sur son bord extrême, celui de la déduction syllogistique parfaite ?
La métis est bien une forme d’intelligence et de pensée, un mode du connaître
Nous renouons ainsi avec la tradition des rhéteurs et des sophistes de la Grèce antique : « La prudence et l’habileté ne se réduisent plus à l’intuition et à la justesse du coup d’œil, mais se fondent sur la délibération en vue de faire des choses en fonction d’un but proposé… Cerner une réalité qui se projette sur une pluralité de plans, un piège pour la chasse, un filet de pêche, l’art du vannier, du tisserand, du charpentier, la maîtrise du navigateur, le flair du politique, le coup d’œil expérimenté du médecin, les roueries d’un personnage retors comme Ulysse… ». Nous pouvons aujourd’hui « repérer… la façon dont les Grecs se sont représenté un certain type d’intelligence engagée dans la pratique, affrontée à des obstacles qu’il faut dominer en rusant pour obtenir le succès dans les domaines les plus divers de l’action… Sans doute n’y a-t-il pas de traité de la métis comme il y a des traités de logique… Pourtant la métis est bien une forme d’intelligence et de pensée, un mode du connaître. Elle implique un ensemble complexe, mais très cohérent, d’attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la précision, la souplesse d’esprit, la feinte de débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportunité, des habiletés diverses, une expérience longuement acquise ; elle s’applique à des réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës, qui ne se prêtent ni à la mesure précise, ni au calcul exact, ni au raisonnement rigoureux... ». Ne reconnaît-on pas, dans cette définition de la Métis l’intelligence rusée que proposent J.-P. Détienne et J.-P. Vernant[iii] (1974), le projet par leque se présente, ou devrait se présenter aujourd’hui, la restauration des sciences de la décision ?
Tous ces divers usages de la raison s’exerçant à « l’art de penser »
C’est à dessein que j’évoque ici ces mots riches d’une longue histoire bien que peu familiers encore dans les cultures académiques contemporaines : Ingenium, Métis, Rétroduction, Rationalité délibérative ou procédurale… Ils évoquent tous ces divers usages de la raison s’exerçant à « l’art de penser »[iv], lequel ne se réduit pas à la logique syllogistique formelle ou à la logique booléenne censée définir « les lois de la pensée[v] ». Je crains en effet, à l’expérience, que le néologisme forgé par H.A. Simon à partir de 1958, pour mettre en valeur ces « autres modes d’exercices de la raison humaine », « Bounded Rationality » (que l’on traduit par « rationalité limitée », alors que l’on pourrait tout aussi correctement dire « rationalité abondante »), n’induise bien des lecteurs en erreur.
Un concept n’a pas de limite
H.A. Simon veut explicitement souligner que bien que les capacités cognitives des êtres humains (et les capacités computationnelles des ordinateurs) soient quantitativement limitées, que cette limite soit proche ou lointaine, la raison humaine est manifestement capable de mille détours et ruses ingénieuses. Exercices cognitifs familiers et communicables, qui permettent à l’esprit humain raisonnant de contourner ces limitations et de proposer un ou plusieurs projet d’action possible à la plupart des problèmes qu’il se pose (quitte à se les poser différemment[vi]). Projets d’actions possibles qui apparaîtront rarement comme parfaitement et définitivement satisfaisants (ou optimum), mais que l’on tiendra pour praticables et recevables ici et maintenant. (Solutions que H.A. Simon proposera d’appeler « satisficing »[vii]). Ce n’est pas la rationalité qui est limitée ou illimitée (un concept n’a pas de limite !), ce sont les capacités cognitives des êtres humains, aussi remarquables soient-elles.
En utilisant le mot « bounded rationality », H.A. Simon laissait implicitement entendre qu’il devait exister des disciplines ou des scientifiques capables de « rationalité illimitée »… Et bien sûr, chacun préfère être considéré dans la cour des grands (illimités) que dans la cour des petits (limités).
« Bounded rationality, une erreur stratégique »
L’économiste anglais R.Marris[viii] a eu raison, je crois, de noter que le choix de ce mot fut « une erreur stratégique, une crucifixion paradigmatique ». L’alternative qu’il propose « rationalité intelligente » est sans doute symboliquement pertinente, mais on peut craindre qu’elle relève du pléonasme ! L’effet induit par l’analogie suggérée par la formulation de H.A. Simon — « rationalité limitée » = « rationalité au rabais » — s’est en effet avéré très pénalisant pour le développement des sciences de la décision et en particulier pour l’étude des processus de décision organisationnelle. Les tenants des mathématiques de la décision eurent tôt fait de clamer qu’il ne fallait pas abandonner un domaine aussi noble que la décision à une « rationalité au rabais » puisque limitée. Les techniques mathématiques d’optimisation (dont on oublie de rappeler qu’elles sont nécessairement monocritére) gardèrent ainsi leur prestige, et l’irruption des paradoxes formels suscités par le problème du « Dilemme du prisonnier » ne suffit pas à déstabiliser cette normale assurance[ix] . H.A. Simon en eut, je crois, conscience dans ses dernières années : il utilisa de plus en plus des expressions telles que « rationalité procédurale » ou même « rationalité pratique » (« practical rationality »).
La décision est-elle un produit analysable ?
Cette tension entre les deux modes de formation et de légitimation des connaissances, entre la platonicienne et la pyrrhonienne, affecte non seulement nos conceptions de la rationalité, mais aussi nos conceptions des processus de décision. Les premiers tiennent la décision pour un produit, produit qu’il est possible de faire « bien » (la « bonne décision », ou plutôt la décision présumée seule parfaitement rationnelle, insurpassable et par-là optimum unique et algorithmiquement calculable) ; un produit analysable, dont on peut agencer les parties élémentaires présumées toutes exhaustivement décrites et évaluées, en « longues chaînes de raisons toutes simples » que l’on pourra enseigner. Les décisions des abeilles dans la ruche, archétype de l’organisation économiquement optimale, constituent ici la métaphore de référence[x].
La décision n’est-elle pas plutôt un processus concevable ?
Les seconds tiennent la décision pour un processus à la fois organisé et organisant, qu’il est possible de concevoir. La décision n’est plus donnée par un algorithme dont la convergence formelle a été antérieurement démontrée, elle est construite au cas par cas, par des tâtonnements heuristiques (récursions fins-moyens-fins-moyens), parfois réguliers (des « heuristiques programmables », peu dépendants du contexte), parfois singuliers (très dépendant des contextes et toujours multicritères : « Heuristic Search »). H.A. Simon utilise volontiers la métaphore du cheminement intelligent dans un labyrinthe mal connu. Métaphore qui évoque aussi bien le cheminement cognitif décrivant les comportements de l’architecte élaborant un plan par simulations de type essais erreurs[xi], ou ceux des responsables d’une organisation élaborant leurs décisions d’action collective.
Ouvrir le champ d’étude de la décision
Le paradigme du système de décision que H.A. Simon proposera dés 1961[xii] en interprétant cette métaphore (la boucle itérative « Intelligence-Conception-Sélection ») nous livre une grille de modélisation (un « pattern », ou un méta modèle) des processus de décision organisationnelle qui s’avère toujours aussi pertinent. Il ouvre les modèles fermés qu’explorent les modèles des mathématiques de la décision, pour lesquels doivent être donnés a priori la description des contextes actuels et futurs, la liste des actions possibles à considérer, le critère par rapport auquel il faudra les évaluer et la fonction d’évaluation correspondante. Comme, en pratique, ce sont précisément ces caractéristiques que doit concevoir et élaborer le processus de décision, car elles ne sont que très partiellement « données », on comprend la nécessité de cette « ouverture » préalable… et on doit regretter que tant d’enseignants aient si longtemps tardé à souligner son importance, se résignant à simplifier à l’extrême la formulation du problème au point de le mutiler, pour s’attacher à la sophistication d’algorithmes informatisables de résolutions de problèmes qui ne se posent pas.
L’exploration de la partie immergée des sciences de la décision suscitée par l’œuvre de H.A. Simon conduit à « changer le regard » et à modifier assez sensiblement nos représentations des processus de décision organisationnelle.
Décider de s’informer plus qu’informer la décision
Le bon vieux modèle de J.W. Forester (1961) s’inverse : la décision n’est plus d’abord « le processus qui transforme l’information en action », mais celui qui transforme les projets des acteurs en alternatives d’actions possibles. Il n’importe plus d’abord de « bien informer » a priori la décision pour qu’elle élabore automatiquement les « bonnes actions ». Il s’agit de concevoir et de rechercher, voire de construire les informations (ces « signes, signifiés, signifiants ») qu’il serait pertinent de considérer pour concevoir des projets d’action.
S’organiser pour décider plus que décider de l’organisation
Il ne s’agit plus de décider (une fois pour toute ?) de l’organisation qui permettra de bien produire (et donc de bien s’informer), il s’agit de tenter de s’organiser pour parvenir vaille que vaille à élaborer en délibérant des décisions que les acteurs de l’organisation pourront intelligemment mettre en oeuvre. Quiconque a eu à « appliquer une décision » à l’élaboration de laquelle il n’a pas été associé et qu’il tient pour idiote, n’a pas besoin de suivre un cours pour comprendre que le vieux modèle linéaire qu’on lui enseignait n’est sûrement pas très pertinent.
L’organisation forme l’information qui la forme
Il ne s’agit plus enfin de se fier naïvement au « modèle de l’ordre à partir du bruit » ou de l’auto organisation par l’information circulante : l’organisation n’est pas seulement un réseau de canalisations dans lequel circulent des informations données on ne sait par qui ni pourquoi ! L’organisation est aussi et peut être surtout un producteur d’informations[xiii] par lesquelles elle se représente sa propre activité et ses propres transformations. C’est elle qui se les construit en permanence et, ainsi, leur donne du sens par rapport à ses propres projets eux même évoluant : c’est en décidant de « former des informations » que « l’organisation se transforme ».
Les sciences de la décision sont sciences d’ingénierie
Autant de changements de regard sur la décision organisationnelle qui renouvellent notre entendement. Décision, information, organisation ne sont plus considérées comme des objets que l’on peut analyser et structurer quasi définitivement dans un manuel d’enseignement. Ils s’entendent comme des processus que l’on peut concevoir par rapport à quelques projets explicitables dans quelques contextes identifiables. Comme les sciences de la cognition, les sciences de l’information, les sciences de l’organisation, les « nouvelles sciences de la décision organisationnelle » (« The new science of management decision ») deviennent des sciences fondamentales d’ingénierie, et ne sont plus des sciences d’analyse ancillaires. Elles appellent alors en permanence leur critique épistémologique interne, attentive à l’intelligibilité et à l’opérationalité de leurs propositions.
Les sciences de la décision s’inscrivent désormais dans l’aventure de la connaissance
Ces quelques réflexions sur la progressive formation dans le champ des connaissances enseignables ici et maintenant des sciences de la décision sont suscitées par l’invitation des jeunes collègues qui se sont attachés courageusement à ces « dialogues critiques » en s’efforçant de reconsidérer les enseignements qu’ils ont mission de développer sur l’étude des processus de décision. J’avais à peu près leur age lorsque, après une quinzaine d’année de responsabilités diverses au sein de grandes organisations, j’eus la chance d’entrer dans la librairie de la « Sloan School of Management » (MIT, Cambridge, Mass. USA), début janvier 1971. Deux petits ouvrages aux titres insolites pour moi à l’époque, rédigés par un auteur dont on ne parlait guère alors en France, H.A. Simon, retinrent vite mon attention : « The new science of management décision » (1960) et « The science of the artificial » (1969).
Je garde le souvenir vif de mon enthousiasme dans les jours qui suivirent de ces lectures émerveillées : c’était exactement ce que je quêtais, en vain me semblait-il auparavant, stupéfait de l’écart que je percevais expérimentalement tous les jours entre ce que l’on voulait faire, (décider intelligemment et de façon créative), et ce que l’on aurait du faire, (appliquer correctement les théories normatives de la décision !). Avec mes collègues d’alors, imbus, dans les années soixante, de nos savoirs en recherche opérationnelle, en cybernétique et « dynamique des systèmes », en économétrie et « statistique de la décision », en programmation dynamique et en théorie des jeux, et, bien sûr, en informatique d’alors, je prétendais toujours que si les décisions optimum que nous avions scrupuleusement calculées n’étaient pas appliquées alors qu’elles étaient si « rationnelles », ce devait être pour « de basses raisons politiques ».
Mais je sentais confusément que mon explication était un peu légère. Plutôt que de vouloir « appliquer la théorie à la pratique », ne pouvait-on « élaborer des théories à partir de la pratique » ? Ce que je découvrais dans la librairie de la Sloan school, c’était que cette question n’était pas du tout stupide. Non seulement H.A. Simon l’avait fait, mais il l’avait soigneusement argumenté, en étayant ses propositions par de soigneuses observations empiriques, et par une exemplaire critique épistémologique interne. Je savais en rentrant des USA en septembre 1971 que nous disposions d’un socle paradigmatique solide sur lequel pouvait désormais s’édifier une « nouvelle science de la décision » qui ne perdait rien de l’acquis traditionnel, mais qui ne s’y enfermait pas et nous ouvrait de nouvelles voies.
Avec enthousiasme, je tentais aussitôt de diffuser ce message dés mon retour en France (mon livre sur « Les systèmes de décision dans les organisations » fut rédigé en 1972-73 et parut début 1975, et ma traduction de la première édition de « The sciences of the artificial » parut en 1974. Je confesse volontiers que les cultures académiques françaises restèrent longtemps inattentives (et parfois hostiles) à ce renouvellement (ou à cette restauration) des sciences de la décision — plus que je ne l’avais anticipé alors. Mais mon enthousiasme ne faiblit pas, vite renforcé par mes découvertes des œuvres scientifiques et épistémologiques de J. Piaget et de E. Morin[xiv] puis de P. Valéry, de G. Bachelard, de H. von Foerster et d’I. Prigogine, qui toutes, à partir de références différentes, confortaient ma conviction. Les sciences de la décision se doivent d’assurer dans et par leur pratique, leur critique épistémique interne.
Le chemin se construit en marchant
Enthousiasme avivé aujourd’hui en rencontrant les travaux des jeunes enseignants chercheurs qui s’attachent à ces « dialogues critiques » en réfléchissant sur leurs expériences d’enseignement et de recherche sur les processus de décisions dans les organisations. Certes, les uns oeuvrent plus dans une inspiration de type platonicien, alors que les autres se référent plus volontiers à une inspiration de type pyrrhonicien, si je peux reprendre ces qualificatifs épistémologiques trop sommaires. Mais les uns et les autres s’efforcent à l’ouverture de leur domaine, en tentant d’écouter les autres. Tous n’y parviennent peut-être pas également ni aisément, mais, là comme ailleurs, « le chemin se construit en marchant ». Nous explorons ces labyrinthes en tâtonnant, heureux de quelques rencontres, éclairés par tel échange inattendu, déçu parfois par telle autre lecture. Ne pas se satisfaire d’un résultat tenu pour définitif quelle que soit sa beauté formelle, n’est ce pas la caractéristique de l’aventure de la connaissance que nous avons le privilège de vivre, dans et par l’enseignement et la recherche ?
Aussi faut-il remercier ici Jean-Robert Alcaras et ses collègues d’avoir eu le courage et la volonté de continuer l’aventure et de nous inciter ainsi à transformer nos expériences en science avec conscience, en s’attachant à « travailler à bien penser ». Peut-être pourront-ils être plus attentifs aux développements contemporains des sciences de la cognition et de la psychologie sociale ?
Mais aujourd’hui profitons de notre chance : pour faire germer les prochains développements des sciences de la décision et des sciences de l’organisation, nous labourons un terreau épistémique bien moins desséché qu’il ne l’était lorsque commencèrent à intervenir au début des années 1950 H.A. Simon et A. Newell aux USA, E.Morin et Y. Barel en France, et bien d’autres. N’avons-nous pas à mieux comprendre un phénomène perçu très complexe : comment se peut-il que les organisations humaines parviennent vaille que vaille à décider de leurs comportements, alors que chacune de leurs décisions ou presque devrait susciter une crise grave et souvent mortifère ? Cela n’est-il pas « merveilleux et pourtant compréhensible », observait H.A. Simon citant la célébre devise de Simon Stevin, dit Simon de Bruges[xv] ? A « comprendre pour faire afin de comprendre pour faire », nous sommes tous invités. Sachons gré à ceux qui reprennent « l’exploration du champ des possibles ».
[i] Il faudrait dire: « Un système – personne », et un « système – organisation », le préfixe système symbolisant « un processus téléologique perçu actif et évolutif dans ses contextes ».
[ii] En témoignent les éditions successives de son principal opus épistémologique, « The sciences of the artificial », (traduction française de sa dernière édition : « Les sciences de l’artificiel », Folio-Essais, 2004) que complète ici, « Reason in Human Affairs » (1983).
[iii] M. Détienne, J.P. Vernant, « Les ruses de l’intelligence, la Métis des grecs », Ed Flammarion, 1974. Voir p. 10 et 305.
[iv] Allusion au célébre Traité de Port-Royal, d’Arnaud et Nicole « La logique ou l’art de penser » (1662-1683, réédition ed Flammarion, 1970), qui allait fonder dans l’enseignement européen le primat symbolique de la logique syllogistique parfaite, ou cartésienne.
[v] G. Boole, « Les lois de la pensée », 1854, trad. Ed. Vrin-Mathésis, 1992.
[vi][vi] Dans son étude, chapitre 4 de cet ouvrage, L. Ducau illustre de façon plaisante et pédagogique cet argument par la parabole de la mouche et de la diligence.
[vii] H.A. Simon crée ce néologisme en empruntant un vieux mot irlandais, pour souligner une différence avec le mot « satisfying », en français « satisfaisant ». J’ai tenté en vain de trouver un bon équivalent français de ce mot « satisficing » (« valant satisfecit », « adéquate »,…). Aussi je propose de franciser le mot satisficing comme furent aisément francisés les mots beefsteak ou pull-over.
[viii] «…It was a strategic error to defer to orthodoxy by renaming the topic as 'bounded' rationality… a 'paradigmatic crucifixion' …I would prefer to describe the type of mental process characterized by the writing of Simon … as 'Intelligent Rationality'. Robbin Marris, in chapter 10 of “Economics, Bounded Rationality and the Cognitive Revolution – Herbert Simon” edited by M. Egidi & R.Marris, Edward Elgar pub. Cy, 1992. p. 198-199.
[ix] Voir par exemple : JC Passeron, et L Gerard Varet, eds. « Le modèle et l’enquête, les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales » (Ed. de l’EHESS, 1995).
[x] On montre que la forme hexagonale des cellules de cire et celle de l’angle à la base du rhomboèdre qui les ferme sont exactement celles qui minimisent la quantité de cire – la ressource rare – pour stocker un volume donné de miel.
[xi] On connaît la parabole de K Marx : « Par la perfection de ses cellules de cire, l’abeille confond l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui fait la supériorité de l’architecte le plus banal sur l’abeille la plus experte, c’est qu’il construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche » (Le Capital, Vol. 1, ed NRF la Pléiade, p. 728).
[xii] La première édition de « The new science of management decision » paraît en 1960 (Prentice Hall, Inc.). Par ses chapitres intitulés « The process of management decision » et « Organizational design : Man machine systems for decision making », elle présente l’essentiel des « connaissances enseignables » sur lesquelles peut aujourd’hui encore s’appuyer un enseignement des sciences de systèmes de décision.
[xiii][xiii] Edgar Morin, dans le Tome 1 de La méthode, 1977, propose très heureusement d’appeler « Informations génératives » de telles informations, qu’il distingue de ‘l’information circulante’ (générée avant et ailleurs, et souvent acquises plus que « données »).
[xiv] Je me souviens du scandale que j’avais provoqué lors d’un Colloque international à l’Université Laval, (Québec, 1982), sur « L’aide à la décision », en justifiant mon propos (« Les sciences de la, décision sont sciences d’ingénierie, plus que sciences d »analyse ») devant un aréopage de spécialistes de recherche opérationnelle, par une référence à mon « Triangle d’or épistémologique : P. S. M ». ( pour Piaget, Simon, Morin). Rares étaient les participants qui connaissaient ces trois noms.
[xv] H A Simon, « Les sciences de l’artificiel » (traduction, Folio-Essais, 2004), p. 26.
Fiche mise en ligne le 12/10/2005