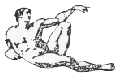| Rédigée par DEMAILLY André sur l'ouvrage de MORAND Bernard : |
| « Logique de la conception. Figures de sémiotique générale d’après Charles S. Peirce » Ed. L’Harmattan, Paris, Collection « Ouverture Philosophique », ISBN : 2-7475-6366-9, Avril 2004, 289 pages. |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
On pourrait résumer très lapidairement cet ouvrage en disant qu’il s’agit d’une présentation de la sémiotique de Charles S. Peirce (1839-1914) par un enseignant-chercheur en génie logiciel. On ajouterait aussitôt que seul un tel spécialiste pouvait le faire aussi bien. On s’attardera d’abord sur cette dernière remarque. Francisco J. Varela (in « Invitation aux sciences cognitives », 1988, 1996, p. 95) soulignait que « la plus simple action cognitive demande une quantité de connaissances apparemment infinie que nous prenons pour acquise (qui est en fait tellement évidente qu’elle en est invisible), mais qui doit être servie à l’ordinateur à la petite cuillère ».
Bernard Morand fait donc partie de ces informaticiens qui nourrissent la machine non seulement en « connaissances de base » (par exemple, « une table est constituée d’un plateau horizontal reposant sur 4 pieds verticaux ») mais aussi en procédures opératoires susceptibles de les traiter ou « computer ». Il est aussi de ceux qui reconnaissent pour ce faire la supériorité des nouveaux langages-objet (de la famille UML, par exemple) sur les langages formels du passé, de par leurs capacités tant descriptives (constitution de classes d’objets selon leur structure et leur comportement) que dynamiques (processus de transformation et de mise en relation de ces objets). Or un ordinateur ne traite pas directement de la réalité mais de signes qui la représentent. Mais c’est aussi le cas de la pensée humaine et le propos de Charles S. Peirce était justement de fonder une science qui permette de comprendre comment l’homme pense au moyen de signes et peut accéder ainsi à la vérité. Autrement dit, le cheminement du praticien qui alimente l’ordinateur en signes ne pouvait qu’entrer en résonance avec celui du théoricien qui s’interroge sur la diversité, le jeu et l’effet des signes ; et le praticien était particulièrement bien placé pour illustrer les propos plus abstraits du théoricien.
Certains lecteurs de cet ouvrage se passionneront directement pour le pont qu’il établit entre génie logiciel et sémiotique peircéenne, mais la plupart seront davantage intéressés par ce qu’il peut dire de la conception technique, architecturale ou artistique, comme le laisse entendre son titre « Logique de la conception ». L’œuvre de Peirce peut-elle y jeter quelque lumière ? L’auteur y répond par l’affirmative et en apporte notamment la preuve dans le dernier chapitre intitulé « Les diagrammes en conception ». On sait que ces diagrammes constituent une étape décisive et un outil majeur de la conception, que ce soit sous la forme de figures de géométrie, de notation chimique, d’esquisses d’architectes, de schémas d’ingénieurs ou de modèles en bien d’autres domaines (y compris, bien entendu, la programmation-objet). S’interrogeant sur les raisons de cette place prééminente, Bernard Morand s’appuie sur un article célèbre de Larkin et Simon (« Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words ? », 1987) qui fait état de trois propriétés spécifiques des diagrammes : leur caractère visuel, leur conformité à l’objet qu’ils représentent et leurs potentialités cognitives particulières. S’en tenant au diagramme consigné sur un document externe qu’ils comparent à un texte rédigé également sur ce type de support, Larkin et Simon estiment 1) que la représentation propositionnelle (texte sous forme de mots) ne préserve qu’une information sur des relations de séquence temporelle ou logique, alors que la représentation diagrammatique préserve une information topologique entre les composants d’un objet ; 2) que cette information spatiale est plus propice aux inférences et à la communication entre humains.
Mais ils s’en tiennent à ces différences fonctionnelles et se gardent de les extrapoler au fonctionnement même de la pensée. Bernard. Morand constate alors que la psychologie ne peut aller plus loin que cette analyse fonctionnelle, dès lors qu’elle se propose d’en trouver les fondements du côté de l’encodage de l’information, au travers de modèles inconciliables et offrant peu de perspectives de recherche en dehors de l’intelligence artificielle : 1) celui de l’encodage propositionnel des perceptions, sous forme de symboles amodaux (Fodor), au risque de perdre toute conformité de l’image mentale à son objet ; 2) celui de leur encodage pictural ou quasi photographique (Kosslyn), au risque de couper le traitement de celles-ci des autres types de traitement ; 3) celui du « double codage », à la fois propositionnel et pictural (Paivio), qui additionne surtout les inconvénients des deux précédents. Face à cette impasse de la psychologie, il faut donc envisager les choses de plus haut, au niveau d’une logique qui ne serait plus une logique formelle, épurée à l’extrême, mais une logique de l’ensemble des signes. C’est ce qu’entreprend Peirce pour qui la logique relève de la science des signes ou « sémiotique générale » :
« Le terme « logique » est employé par moi […] en deux sens distincts. Dans son sens le plus étroit, il s’agit de la science des conditions nécessaires de l’acquisition de la vérité. Dans son sens plus large, c’est la science des lois nécessaires de la pensée, ou, encore mieux (la pensée prenant toujours place au moyen de signes), c’est la sémiotique générale, qui traite non seulement de la vérité, mais aussi des conditions générales des signes existant comme signes […], et encore des lois de l’évolution de la pensée, puisqu’elles coïncident avec les conditions nécessaires de la transmission de la signification par signes d’un esprit à l’autre, et d’un état d’esprit à un autre […]. Collected Papers, 1.444 (pp. 61-62 de « Logique de la conception »).
Pour lui, le diagramme fait partie, parmi l’ensemble des signes, de la classe des icônes qui se distingue elle-même de celles des indices et des symboles. La caractéristique majeure d’une icône tient dans sa ressemblance avec l’objet qu’elle représente ainsi que dans sa capacité à en dériver certains traits implicites à partir de l’expérience que l’on peut en avoir par ailleurs, à la différence de l’indice (qui établit une connexion physique avec la dynamique de l’objet, à l’instar de la girouette par rapport au vent ou du symptôme par rapport à la maladie) ou du symbole qui est lié par convention à son objet. Au sein de la classe des icônes, le diagramme se différencie des images et des métaphores. L’image se caractérise par ses capacités de description et la métaphore par ses capacités de mise en relation. Entre les deux, le diagramme se caractérise par ses capacités de désignation des relations des parties au tout de l’objet représenté, tant actuelles que potentielles, tant possibles qu’impossibles. C’est ce qui explique justement son aptitude à engendrer le raisonnement, notamment abductif : il lui arrive de faire apparaître un fait surprenant (dérangeant les théories jusqu’alors admises) qui invite à formuler « ce que devraient être » ses conditions d’apparition et à retenir celles-ci comme hypothèse probable ou raisonnable.
Ce chapitre terminal ne peut être apprécié et savouré qu’après lecture des précédents qui exposent avec clarté et sobriété l’impressionnant montage peircéen (en se demandant comment ce personnage, plus isolé que reconnu, a pu creuser avec constance et cohérence le même filon, pendant près de 50 ans, sans devenir fou[1]). Il serait présomptueux de vouloir les résumer en quelques lignes et on se contentera d’en souligner quelques points-clés.
On notera que la pensée de Peirce est foncièrement ternaire, dynamique et réticulaire. En ce qui concerne le premier trait (ternaire), il définit d’emblée trois catégories d’analyse de la réalité, telle qu’elle se présente à l’esprit (ce qui inclut aussi les choses imaginaires), et autant de relations logiques. Ainsi, la priméité correspond « au mode d’être de ce qui est tel qu’il est et sans référence à quoi que soit d’autre » (par exemple, « un parfum » ou « le ton d’une couleur ») ; autrement dit, à une qualité (prédicat uniplace). La secondéité implique la relation de deux éléments ; c’est celle des faits bruts qui s’imposent à l’esprit, indépendamment de toute autre considération extérieure (prédicat biplace tel que « le chat mange la souris »). La tiercéité implique la relation d’au moins trois éléments ainsi que la médiation de faits actuels ou passés avec des événements futurs, avec l’idée qu’elle peut déboucher sur une habitude (par exemple, « j’assimile « pensée » à « signe » ») ou sur une loi (par exemple, « le moteur transforme de l’énergie en mouvement ») ; « c’est donc la catégorie de la représentation » (p. 57). Le signe lui-même est défini de manière triadique : un signe est toujours quelque chose tenant lieu de (S pour Signe) quelque chose (O pour Objet) pour quelqu’un (I pour Interprétant). Cette définition générique du signe va donner ensuite lieu à des subdivisions par trois. Ainsi, le croisement des 3 principes catégoriels et des 3 traits du signe donne lieu à trois trichotomies : 1) celle du signe en lui-même (qualisigne, signe singulier, légisigne) ; 2) celle du signe en relation à son objet (icône, indice, symbole) ; 3) celle du signe en relation à son interprétant (rhème, « signe qui dit », argument). Qualisigne, icône et rhème relèvent de la priméité et de la possibilité (rien n’est sûr tant en ce qui concerne le signe lui-même que son rapport à l’objet et son mode d’interprétation). Signe singulier, indice et « signe qui dit » relèvent de la secondéité et de l’actualité (le signe singulier est patent et lié à son objet mais ne peut déboucher sur aucune loi). Légisigne, symbole et argument relèvent de la tiercéité et de la nécessité (des propositions sous forme de symboles logiquement reliés).
Pour Bernard Morand, cette classification statique et apparemment absconde se démarque de la vision positiviste de l’époque (qui perdure toujours) et ne correspond pas à certaines exégèses qui en ont été proposées. D’un côté, le positivisme ne retient, en quelque sorte, que l’axe de la tiercéité en réduisant la pensée au traitement de symboles (sans se préoccuper des icônes et des indices) et en gommant ce qui a trait au signe en lui-même (1ère trichotomie) et à sa relation à son interprétant (3ème trichotomie) ; ce qui ferait de la pensée un univers autonome qui serait soumis à ses propres lois (supposées isomorphes à celles qui régissent le reste du monde) et dont les symboles arbitraires seraient paradoxalement capables de signifier. De l’autre, des commentateurs tels que Ogden et Richards (in « The Meaning of Meaning », 1923) ne retiennent que la 2ème trichotomie (icône, indice, symbole) et traduisent S, O et I par « symbole », « référent » et « pensée » en n’examinant que leurs relations dyadiques : 1) entre pensée et symbole (relation de symbolisation) ; 2) entre pensée et référent (relation de référence) ; 3) entre symbole et référent (relation de représentation). Par ailleurs, Morris (in « Signs, Language and Behavior », 1946) reprend ces relations dyadiques en soulignant 1) la fonction syntaxique de la composition des symboles ou signifiants pris en eux-mêmes ; 2) la fonction sémantique de la relation du symbole ou signifiant à son objet ou signifié ; 3) la fonction pragmatique des effets ou usages du signe en situation. Bernard Morand note à cet égard :
« Séparer la relation du signe à son interprétant et la relation du signe à son objet revient au contraire à « dégénérer » le caractère médiateur du signe, en faire une paire de relations dyadiques avec d’un côté la relation de « référence » et indépendamment, de l’autre, la relation d’interprétation. En particulier, le signe se trouve alors dépourvu de toute capacité à exprimer la généralité attendue du futur. Démuni de possibilités d’anticipation, il perd ce qui fait le caractère propre de la représentation. Transposons en substituant « pensée » à « signe » : un signe constitué de relations dyadiques serait une pensée réactive du moment présent vis-à-vis du passé, inapte à faire des plans et incapable de progresser. Faute d’une relation triadique authentique, un système de représentation serait un système qui n’évolue pas, fixé une fois pour toutes » (p. 67).
En ce qui concerne le deuxième trait (dynamique), le système peircéen révèle toute sa fécondité en soulignant que la pensée est avant tout mouvement et que tout signe vise à engendrer un interprétant, un nouveau signe qui se trouve dans la même relation à l’objet. C’est ce qui permet de mieux comprendre la notion d’interprétant, qui peut se situer chez un tiers lors d’un processus de communication entre individus ou au sein de l’individu lui-même en train de penser et de raisonner (cognition). L’interprétant n’est pas l’interprète : dans la communication, le récepteur interprète certes les signes que lui adresse l’émetteur mais c’est pour produire d’autres signes (interprétants) qui les traduisent plus ou moins bien (c’est encore plus vrai de la traduction d’un texte ou d’un exposé dans une autre langue) ; dans la cognition, c’est le raisonnement individuel qui traduit des signes issus de la perception ou de la mémoire en d’autres signes ou interprétants. Autrement dit, la classification statique des signes débouche nécessairement sur une « sémiose » dynamique.
Pour illustrer celle-ci, Bernard Morand se sert de nombreux exemples de programmation-objet mais c’est sa « métaphore du parapentiste » qui nous parle le mieux. Le parapentiste saute dans le vide et se sert de multiples signes (savoirs et savoir-faire techniques, sensations internes, indications externes quant à la direction du vent et la configuration de l’espace… bref, une bonne partie de la panoplie des signes) pour piloter son vol ; mais il ignore où il atterrira précisément. Le lieu d’atterrissage constitue à la fois le résultat du vol et l’interruption de son processus, tout comme il ouvre sur son évaluation. En termes peircéens, on dira que le vol est guidé par un interprétant potentiel (le point d’atterrissage ou résultat espéré) et débouche sur un interprétant effectif qui diffère souvent de l’interprétant potentiel mais dont émergent de nouveaux signes qui permettront éventuellement de corriger cet écart. La pensée ne procède pas autrement en guidant son cours sur des interprétants potentiels[2] pour sélectionner les signes pris en eux-mêmes et dans leur relation à l’objet : c’est en cela qu’elle est essentiellement dynamique et ne peut se décomposer en relations dyadiques indépendantes les unes des autres. A cet égard, on peut regretter que l’auteur, qui fait grand usage des métaphores, n’ait pas consacré un chapitre entier à la conception peircienne de celles-ci, qui eût été symétrique de celui qu’il a consacré à la représentation diagrammatique.
En ce qui concerne le troisième trait (réticulaire), il découle des deux précédents. Si les schémas peirciens sont hiérarchiques, ils s’organisent davantage sous forme de treillis que de graphes arborescents tels que l’arbre de Porphyre (d’inspiration aristotélicienne) ou les classifications comtiennes et positivistes. Ce faisant, ils se prêtent bien mieux à des pliages et dépliages réflexifs et dynamiques (cf. figure 14 de la page 228) qui expriment les jeux infinis des signes et des phénomènes. Pour l’illustrer, l’auteur se sert de la belle métaphore du rhizome :
« En effet, le rhizome fournit une image des expansions de parties pour former une totalité des interprétations aussi bien que les réductions de ces parties dans les signes ; une image qui est celle du mouvement de la pensée, « démontable » et « retournable » selon Eco » (p. 229).
Contrairement à d’autres ouvrages qui nous laissent sur notre faim, on pourrait dire que celui-ci nous met en appétit. Plutôt que de commenter en la paraphrasant une pensée complexe qui était très en avance sur son temps, Bernard Morand s’en saisit comme d’une œuvre ouverte dont il amplifie les résonances présentes et futures. Ainsi, le système peircéen s’avère prémonitoire et toujours éclairant quant à la manière d’injecter de la pensée humaine dans des machines par l’entremise de langages artificiels. Il se montre tout aussi fécond quand on s’intéresse à la représentation diagrammatique qui participe à bien d’autres entreprises de conception. Il nous suggère aussi que la science elle-même – celle à laquelle on assujettit encore les techniques parce qu’elle déboucherait sur des « découvertes » et non des « inventions » – est activité de conception, guidée par des interprétants dynamiques qui esquissent « ce que devraient être » les choses. Peirce n’a sans doute laissé qu’une symphonie inachevée mais il est heureux que celle-ci trouve des interprètes de talent, tels que Bernard Morand et, plus indirectement, Norwood R. Hanson - dont l’ouvrage « Patterns of Discovery », 1958, vient d’être traduit en français par Nyano Emboussi (« Modèles de la découverte. Une enquête sur les fondements conceptuels de la science », 2001, voir par exemple : http ://archive.mcxapc.org/cahier.php ?a=display&ID=617 ) - ou Robert Pagès dont on lira ou relira avec intérêt l’article intitulé « Le long courant porteur du signalétique à l’informatique et la rétroaction sur la sociopsychologie » (in P. Ansart (Ed.). Usages et mésusages de l’informatique dans l’enseignement et la recherche en sciences sociales. Paris, Centre de coopération universitaire franco-québécoise, Publications de la Sorbonne, 1988).
André Demailly
[1] On ne peut manquer de comparer le parcours de Peirce à celui de son contemporain Boltzmann (1844-1906) qui fut confronté lui aussi tant aux grandes constructions philosophiques de Kant et de Hegel qu’aux certitudes positivistes de ses pairs (dont Mach) et se suicida au moment même où sa théorie thermodynamique allait être pleinement reconnue et où la révolution quantique pointait à l’horizon. Son petit ouvrage de vulgarisation (« Voyage d’un professeur allemand en Eldorado et autres écrits populaires », 1905, traduit en 1987 chez Actes-Sud) entre en résonance avec maints propos peircéens (avec un zeste de darwinisme en plus).
[2] Bernard Morand (p. 119) illustre aussi le rôle de l’interprétant potentiel en recourant à la métaphore du cintre dont se servaient les bâtisseurs médiévaux pour construire une voûte : le cintre lui donnait forme tout en la soutenant jusqu’à l’insertion de la clé de voûte qui la fixait définitivement et le rendait inutile. On pourrait ajouter que la conception de la coupole de Santa Maria del Fiore par Brunelleschi renvoie à un interprétant encore plus virtuel puisqu’elle visait à se passer de clé de voûte et de cintres (tout l’incitant à développer ses épures et croquis tant pour lui-même que pour ses maçons).
Fiche mise en ligne le 12/10/2005