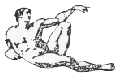| Rédigée par COUDEL Emilie sur l'ouvrage de AVENIER Marie José et SCHMITT Christophe (dir.) : |
| « LA CONSTRUCTION DE SAVOIRS POUR L'ACTION » Edition L'Harmattan, (collection Action & Savoir), 2007, ISBN : 978-2-296-02887-6, 245 pages |
| Voir l'ouvrage dans la bibliothèque du RIC |
Dans « La construction des savoirs pour l’action », Avenier et Schmitt proposent une mise en perspective de réflexions d’un groupe de chercheurs engagés dans l’action, sur les manières dont la recherche peut contribuer à construire, au travers d’un travail épistémique, des savoirs pour l’action. Regards épistémologiques, conceptuels, méthodologiques, ce recueil rassemble deux approches : les sciences de gestion et les sciences de l’éducation. Mais la réflexion est ouverte à l’ensemble des « sciences liées à des pratiques professionnelles relevant de l’intervention dans l’activité humaine » (Avenier, chap. 6). Ce livre nous invite donc, chercheurs impliqués auprès d’agriculteurs ou d’autres acteurs du milieu rural, à nous questionner sur notre propre pratique lorsque nous cherchons à construire des savoirs utiles à l’action de ces acteurs.
Cette note de lecture est un double défi que je relève : je ne suis ni épistémologiste, ni spécialiste de sciences de gestion ou de sciences de l’éducation. Ce n’est donc pas en tant que « critique » que je me pose, mais simplement en tant que « praticienne » de recherche (et novice qui plus est) : comment les savoirs présentés dans ce livre peuvent être utiles à mon action de chercheur?
C’est d’une rencontre entre deux concepts que nait ce livre : les savoirs d’action et les savoirs actionnables. Issus tous les deux de la nécessité d’introduire une visée pragmatique dans la recherche, ces deux concepts ont été développés séparément dans deux disciplines sans connexion. Les savoirs d’action, développés par les sciences de l’éducation, correspondent à des énoncés relatifs à l’action professionnelle que les chercheurs recueillent auprès de praticiens. Les savoirs actionnables sont des savoirs développés par la recherche, notamment de sciences de gestion, et qui sont susceptibles d’être mis en action dans la vie quotidienne des organisations. « Confronter des champs d’expérience différents a permis de faire surgir des questionnements fondamentaux. A force de familiarité intellectuelle, les chercheurs œuvrant dans les mêmes cercles tendent à devenir aveugles aux hypothèses implicites sur lesquelles leur réflexion prend appui » (Avenier, Postface). Acceptons cette provocation à la réflexion pour participer de la confrontation de champs développée dans le livre.
D’abord, il s’agit de se mettre d’accord sur le vocabulaire employé pour désigner les savoirs en relation avec l’action. Vous êtes vous déjà penché sur la différence entre savoir, connaissance, compétence, aptitude ? Barbier (chap. 2) nous propose une lecture très claire, reliant chaque notion à une logique différente, chacune se définissant par un objet, une zone sémantique, un paradigme. A titre d’exemple, un ‘savoir’ est un énoncé stabilisé (extérieur aux individus), alors qu’une ‘connaissance’ est intériorisé par un individu. Sans compter ensuite tous les types de connaissances que nous propose Martinet (chap. 1), basé sur Lam (2000), allant des connaissances individuelles aux connaissances empreintes dans une culture communautaire, en passant par les connaissances collectives. Il replace ces connaissances en lien avec différents modèles organisationnels, le tout défini par différents paradigmes et épistémologies : positivisme, empirisme, constructivisme. Une connaissance actionnable ne se limite pas à une définition, elle doit être rapportée aux processus et cultures dans lesquelles elle s’inscrit.
Considérer la relation entre savoir/connaissance et action incite cependant la plupart chercheurs-auteurs à opérer un bousculement épistémologique. Ceux-ci font le constat que l’épistémologie néo-positiviste qui est le paradigme dominant depuis trois cents ans se révèle limitée lorsqu’il s’agit de prendre en compte les pratiques de l’activité humaine, souvent peu codifiée. La complexité humaine et organisationnelle, façonnée par un caractère intentionnel et créatif, se prête mal à une fixation en « vérités » universelles. Dans ce paradigme, les savoirs actionnables valables se limitent à une mise en œuvre de technologies dérivées des savoirs scientifiques, appliquées de manière mécaniste (Avenier, chap. 6). Ceci amène les chercheurs à développer une nouvelle épistémologie, celle du constructivisme (Le Moigne 1995), où « l’élaboration de savoirs est vue comme un processus de construction intentionnelle de représentations éprouvées par l’expérience sensible ou cognitive » (Avenier, chap. 6). Les savoirs construits ne s’expriment pas comme des principes normatifs universels ni comme des théories prédictives, mais prennent la forme de « propositions génériques », destinées à « éclairer le lecteur, susciter sa réflexion et des questionnements, ainsi qu’à stimuler son imagination et son action créatrice » (Avenier, chap.6). Les savoirs ne sont pas « validés » au sens de Popper, mais « légitimés » par la cohérence de la méthode de construction et par l’usage qui est fait postérieurement des savoirs. Cette épistémologie doit conduire le chercheur a exercer un travail épistémique approfondi. Ce travail épistémique consiste à questionner la pertinence et la cohérence mutuelle des orientations progressivement prises (aux plans théorique et empirique) tout au long du processus de recherche. Ceci impose au chercheur « de rendre explicite l’ensemble des éléments permettant de discuter des énoncés produits » (Giordano 2003). Il s’agit d’argumenter les allers-retours effectués entre questions de recherche, référents théoriques mobilisés et informations recueillies sur le terrain (Avenier, chap.6).
Cette nouvelle posture de recherche a des conséquences sur tout le processus de recherche. Celui-ci doit être explicité au maximum, pour faire sortir de l’ombre la face caché de la conception de la recherche, ne pas gommer la présence du chercheur (Mir et Watson, 2000) et réintroduire une subjectivité dans le travail de recherche. Il est normal que le plan de travail change au long du processus de recherche, mais il faut justifier les orientations choisies. Plusieurs chapitres du livre fournissent des typologies de travaux de recherches, autour des deux approches (savoirs d’action et savoirs actionnables), apportant des éléments qui permettent de réfléchir et justifier les choix de méthodologies. La question qui se pose pour les savoirs d’action, est le dispositif à mettre en œuvre pour permettre aux praticiens d’énoncer des savoirs relatifs à leur pratique, par exemple la manière dont le contexte permet (ou non) la reconnaissance du praticien (Astier, chap.3), et la manière d’inviter ce praticien à adopter une posture réflexive, et non pas de rationalisation ou d’autojustification (Rix, chap. 4). Dans le cas des savoirs actionnables, la question est plutôt comment peut se donner une co-construction entre le chercheur et le praticien (Avenier, chap. 6), voire même comment peut être renversée la perspective, le chercheur « captant » un savoir déjà existant chez les praticiens et le transformant en savoir académique (David, chap. 5). Mobilisant enfin un exemple concret, Lièvre (chap. 7) illustre la difficulté des praticiens à exprimer leurs connaissances tacites, et des scientifiques à proposer des savoirs applicables à partir de leurs recherches académiques.
Une des particularités par rapport à une simple recherche-intervention, comme le font remarquer plusieurs auteurs (David, chap 5. ; Avenier, chap. 6), est la nécessité de généraliser les savoirs élaborés sur un terrain pour pouvoir les activer dans d’autres terrains. Au-delà des problèmes posés par la généralisation (David, chap. 5), il faut être capable de communiquer les résultats à d’autres praticiens que ceux impliqués dans la recherche. Ceci suppose tout un travail de traduction et de mise en scène des savoirs, pour leur donner un sens dans le monde des praticiens (Schmitt, chap. 8). Cette étape n’est pas à prendre à la légère, car plusieurs risques y sont associés. D’abord, si le chercheur ne réussit pas à présenter le statut particulier des savoirs issus de l’épistémologie constructiviste, ceux-ci risquent d’être mobilisés dans une autre épistémologie, pouvant être considérés comme « vérités » ou « règles à appliquer », plutôt que d’être perçus comme des repères destinés à guider la réflexion (Avenier, chap. 6). Ensuite, il s’ensuit un risque pour le propre chercheur : il doit savoir se consacrer à la communication avec les praticiens sans en oublier son travail de recherche, ni perdre sa légitimité auprès de la communauté académique (Schmitt, chap. 8).
Pour nombre d’entre nous, ces pratiques de recherche (selon un mode de recherche-action, recherche-intervention, recherche-accompagnement) sont déjà entrés dans nos mœurs. Mais ce livre peut nous aider à justifier un certain nombre de ces pratiques et à exercer un regard critique, épistémique, sur notre travail de recherche et nous donner comme objectif de produire des savoirs actionnables génériques (dans le sens de généralisables). Dès lors, nous devenons des « praticiens réflexifs » au sens de Tsouksas (2005) : « à la fois, nous menons sans réfléchir nos activités de recherche destinées à engendrer des savoirs nouveaux sur des phénomènes organisationnels d’intérêt, et nous nous engageons dans des discussions concernant la validité de nos énoncés ». La discussion est donc ouverte, et nous avons tout intérêt à la saisir au vol pour décomplexer et consolider la place accordée à l’action dans nos recherches.
L’épistémologie est souvent vu comme difficile d’accès, mais j’ai trouvé, en tant que non initiée, que la plupart des auteurs de ce livre réussissaient à bien faire passer leurs idées, et nous invitent à en faire des savoirs actionnables pour notre recherche. J’ai quant à moi beaucoup tiré de ce livre : j’accompagne depuis deux ans, dans le cadre d’une thèse, un projet d’Université Paysanne au Brésil où je m’implique quotidiennement avec les acteurs du projet. Ce livre m’a conforté dans mon choix d’implication dans l’action, et m’a lancé plusieurs défis : comment rendre encore plus actionnables les « savoirs » que je construis dans ma recherche ? comment les rendre plus accessibles aux acteurs avec qui je travaille ? A la veille de commencer à rédiger, je trouve en ce livre un appui important pour justifier, critiquer et amplifier ma démarche de recherche. emilie.coudel@cirad.fr
Références
Avenier,
Marie-José 2007. Repères pour la transformation
d’expérience en science avec conscience (Chapitre 6).
Avenier, Marie-José 2007. Accords, désaccords et
premières mélodies (Postface).
Astier, Philippe
2007. Dire, faire et savoir. Remarques sur leurs relations à
l’occasion des « discours d’expérience »
(Chapitre 3
Barbier, Jean-Marie 2007. Le vocabulaire des rapports
entre sujets et activités (Chapitre 2). David, Albert 2007.
Scientificité et actionnabilité des connaissances en
sciences de gestion : renversons la perspective ! (Chapitre
5).
Giordano, Yvonne 2003. Conduire un projet de recherche.
Une perspective qualitative, Paris, EMS.
Le Moigne, 1995. Les
épistémologies constructivistes, Paris PUF.
Lam,
2000. Tacit knowledge, Organizational Learning and Societal
Institutions : an Integrated Framework, Organization
Studies, 21/3, pp. 487-513.
Lièvre,
Pascal 2007. La construction de savoirs pour l’action par
intégration de connaissances pratiques « tacites »
et de savoirs scientifiques « classiques »
(Chapitre 7).
Martinet, Alain-Charles 2007. Savoir(s), connaitre,
agir en organisation : attracteurs épistémiques
(Chapitre 1).
Mir et Watson, 2000. Strategic
management and the philosophy of science : the case for a
constructivist epistemology, Strategic
Management Journal, Vol. 21,
p.941-953.
Rix, Géraldine 2007. Une mise en
perspective des modes d’investigation de l’activité
humaine (Chapitre 4).
Schmitt, Christophe 2007. La communication
des savoirs pour l’action (Chapitre 8).
Tsoukas
2005. Complex Knowledge. Oxford University Press.
Fiche mise en ligne le 13/10/2008